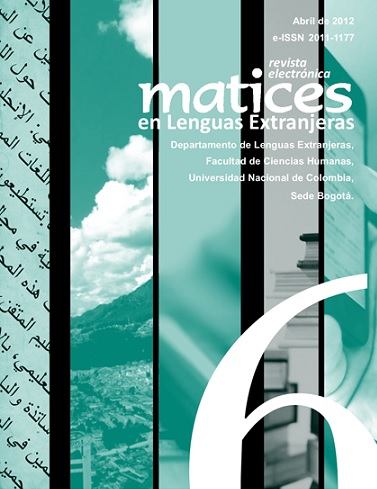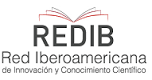La sociodidactique comme didactique de l'intervention
Socio-didactics as Educational Intervention
La sociodidáctica como intervención educativa
Palabras clave:
sociodidactique, recherche-action, intervention (fr)sociodidactique, recherche-action, intervention (es)
socio-didactic, action research, intervention (en)
Entre teoría y práctica, la sociodidáctica se configura más como una dinámica de acciones que como un nuevo campo disciplinar. Este artículo presenta un conjunto de reflexiones de los autores sobre sus respectivas investigaciones. Estas cuestionan el grado de implicación en el campo de la didáctica de las lenguas-culturas. Para eso, un abordaje conceptual es necesario para aprehender las nociones de sociodidáctica e investigación-acción. Finalmente, la dimensión de las tareas en la didáctica.
La sociodidactique comme didactique de l'intervention
La sociodidáctica como intervención educativa
Socio-didactics as Educational Intervention
Damien Le Gal
damien.legalle@amigo.edu.co
Doctor en Ciencias del Lenguaje de la Universidad Europea de Bretaña, Francia
Investigador asociado al grupo de investigación PREFICS
Fundación Universitaria Luis Amigó, Bogotá, Colombia
Claire Vilpoux
clairevilpoux@gmail.com
Doctora en Ciencias del Lenguaje de la Universidad Europea de Bretaña, Francia
Profesora de francés en la Universidad de Avignon, Francia
Investigadora asociada al grupo de investigación PREFICS donde se estudia la enseñanza del francés como lengua extranjera en Ucrania
Université d'Avignon, Avignon, France
Résumé
Entre théorie et pratique, la sociodidactique se situe plus dans une dynamique d'action qu'elle ne présente un nouveau champ disciplinaire. Cet article présente un ensemble de réflexions menées par les auteurs sur leurs recherches respectives. Celles-ci interrogent le degré d'implication dans le champ de la didactique des langues-cultures. Pour ce faire, un éclairage conceptuel sera nécessaire pour appréhender les notions de sociodidactique et de recherche-action, avant de définir la dimension actionnelle de la didactique.
Mots-clés: sociodidactique, recherche-action, intervention.
Resumen
Entre teoría y práctica, la sociodidáctica se configura más como una dinámica de acciones que como un nuevo campo disciplinar. Este artículo presenta un conjunto de reflexiones de los autores sobre sus respectivas investigaciones. Estas cuestionan el grado de implicación en el campo de la didáctica de las lenguas-culturas. Para eso, un abordaje conceptual es necesario para aprehender las nociones de sociodidáctica e investigación-acción. Finalmente, la dimensión de las tareas en la didáctica.
Palabras clave: sociodidáctica, investigación-acción, intervención.
Abstract
Between theory and practice, socio-didactics is more a dynamic of actions than a new discipline. This article presents a set of reflections by the authors on their respective investigations. These call into question the degree of involvement of languages-cultures in the field of didactics. For this, a conceptual approach is necessary to apprehend socio-didactic and action-research notions before establishing the actionable dimension of didactics.
Keywords: socio-didactic, action research, intervention.
Depuis qu'elle a été fondée par Kurt Lewin en 1934, la recherche-action (action research) a traversé de nombreuses disciplines. En éducation, celle-ci apparaît en 1950 en Europe et se développe en 1980 au moment des grandes réformes éducatives. Depuis une dizaine d'années seulement, des travaux en didactique des langues-cultures (désormais DDLC) s'orientent dans cette voie (Macaire, 2007: 102-103).
Comme le suggère le titre, cet article interroge la rencontre entre les concepts de sociodidactique et d'intervention. Ces deux notions impliquent un lien fort avec les méthodes de recherche sur le terrain. Nous insisterons aussi sur l'approche sociodidactique adoptée dans nos travaux et montrerons en quoi celle-ci est favorable au développement de la recherche-action. Un éclairage terminologique sera ensuite apporté sur les notions de recherche-action et de recherche-intervention dans le domaine éducatif. Pour illustrer notre propos, nous prendrons appui sur nos expériences de recherches et tenterons d'expliciter notre posture de recherche-intervention.
La didactique des langues-cultures, un champ propice à l'intervention et à l'action
En lien avec la pédagogie proche du terrain, la didactique est considérée comme la discipline scientifique où sont discutés et interrogés les théories, principes, méthodes et méthodologies qui régissent l'enseignement-apprentissage des langues. L'objet même de la didactique relève autant de la description, qui caractérise traditionnellement la recherche, que de l'action, tout en restant dans le champ de la praxéologie. On peut donc considérer que la didactique est ontologiquement interventionniste voire actionnelle, comme en témoigne la définition d'Henri Boyer pour qui la didactique du français langue étrangère correspond a l'articulation plus ou moins idéale et effective de différentes interventions: théoriques, méthodologiques et pratiques, qui sollicitent diverses disciplines des Sciences Humaines et Sociales en particulier pour mieux aborder la classe dans sa réalité (2001: 7):
Une didactique digne de ce nom comporte aussi bien des réflexions que des propositions et des réalisations. Ainsi toute élaboration méthodologique en matière du FLE puise aujourd'hui ses préalables dans divers domaines de la connaissance : non seulement les Sciences du Langage et de la Communication, on le verra (sociolinguistique, pragmatique, analyse de la conversation, lexicologie, phonétique.) mais également les sciences de l'Education, la Psychologie, l'Anthropologie, la Sociologie, etc. (Boyer et aliii, 2001 (1990): 7-8, mise en exergue par les auteurs).
De même, Daniel Coste souligne la force propositionnelle et la pertinence d'une intervention en didactique. Celle-ci est envisagée comme une étape en aval d'une prise de décision (ou d'une action) qui a pour vocation de modifier les habitus et orientations des acteurs de l'enseignement-apprentissage.
En tant que discipline d'intervention, la didactique des langues puise sa légitimité, en dernier ressort, dans la pertinence et l'efficacité des propositions qu'elle formule, des orientations qu'elle suggère. Elle fonde ces orientations et propositions, aussi rigoureusement que possible, sur les descriptions et analyses qu'elle peut mener des phénomenes qui l'intéressent, sur les explications qu'elle peut avancer de ces phénomenes. Elle doit évidemment prendre en compte les hypothèses, observations et résultats dus à d'autres disciplines et de nature à intéresser son propre domaine. Mais cette démarche d'ensemble s'inscrit, à un moment et dans une configuration épistémique donnée, en relation à un projet de recherche et d'action. (Coste dans Castellotti, 2001: 192-193, mise en exergue par les auteurs).
Nous rejoignons ces auteurs et posons que l'une des principales finalités de la didactique est l'action pédagogique. De facto, la didactique interroge les pratiques et d'élaboration du déroulement des classes, entre autres.
Les apports de la sociodidactique
La sociodidactique est un espace de recherche qui croît sans cesse en complexité. Celle-ci est le lieu d'analyse et de réflexion sur les conditions de l'enseignement-apprentissage des langues, de prise en compte des facteurs internes et externes au systeme éducatif étudié. La (socio)didactique s'intéresse également aux politiques linguistiques (des états, de l'Europe.) ainsi qu'aux variétés de langues-cultures et à leur place dans la classe. Son travail porte donc sur les dimensions micro, macro et mésosociales (Macaire, 2007: 97) de l'enseignement-apprentissage.
Pour Rispail le terme de sociodidactique fait référence a une « (sous)discipline affirmée, (socio)linguistique et didactique mêlées, qui se donnerait pour objet d'étude la vie des langues dans et à travers l'école, dans leurs interactions avec leurs autres usages sociaux » (2005, p. 100). La sociodidactique reconnaît le lien entre l'espace d'enseignement-apprentissage et le monde social auxquels les acteurs (ici enseignants, apprenants) appartiennent et traduit cette appréciation a tous les niveaux de la recherche. Elle prend en compte le fait que les pratiques et représentations sociales sont susceptibles de conditionner ou d'influencer les acteurs de l'enseignement-apprentissage et vice-versa.
La valeur sociale suggérée par le préfixe « socio- » insiste sur l'importance des interactions entre la société et le milieu scolaire/universitaire que l'on peut identifier par l'observation. A la différence de travaux en didactique relevant davantage de la psychologie cognitive, de la psychologie du développement ou d'approche systémique des contacts de langues et de l'analyse de la langue cible pour l'amélioration de l'enseignement-apprentissage des langues, la socio-didactique ajoute à ce bagage épistémologique la prise en compte du social dans l'élaboration de ses principes, sa méthodologie.
Mesurant le poids du social, la sociodidactique ne se contente pas seulement d'une description des contextes mais cherche à apporter des solutions en s'associant à des interventions voire à des actions à des fins politiques, pédagogiques, sociales.
Dans son intérêt poussé pour l'environnement social, la socio-didactique met en oeuvre le principe de contextualisation. Elle aborde les phénomênes en les situant dans leur environnement et étudie ce dernier. La socio-didactique suppose que la production par la recherche de connaissances qualitatives sollicite la compréhension des éléments constitutifs du contexte puisque ceux-ci influent sur les actions, pratiques et représentations des acteurs sociaux. L'ethnographie fournit les outils efficaces de la description des contextes et situations étudiés. Ce travail ethnographique est une préparation nécessaire et efficace à des interventions intégrées et à des actions appropriées, il s'agit d'une composante fondamentale de toute recherche à vocation interventionniste.
Acteurs, contextualisations et processus constituent les maîtres-mots reliant sociodidactique et intervention.
Recherches et postures
Nos expériences de recherche nous ont amenés à nous interroger, d'une part, sur la notion de recherche-action. D'après Paillé, celle-ci présente les caractéristiques suivantes :
- Elle est naturaliste c'est-à-dire qu'elle s'effectue sur les lieux mêmes de l'action, avec les acteurs concernés, à l'aide de procédés tres peu encombrants ;
- Elle fait appel le plus souvent à des méthodes qualitatives de cueillette [recueil pour nous] de données (interview, observation, collecte de documents) ;
- Elle recourt essentiellement à des méthodes d'analyse qualitative ou quasi-qualitative elle donne lieu à un compte-rendu et à une analyse de l'action plutôt qu'à un exposé de résultats (2004: 223).
Il énonce que la recherche-action est un objet méthodologique complexe en ce que, dans son essence même, elle est au moins quadruple : recherche appliquée, recherche impliquée, recherche imbriquée et recherche engagée (2004: 223).
La recherche-action est recherche appliquée parce que son objet d'étude, en Sciences Humaines, est sujet et que la recherche s'applique à celui-ci : « La recherche-action est ainsi une recherche appliquée à l'action de ce sujet, mais aussi à partir de l'action de celui-ci » (Paillé: 224). Damien Le Gal étudie et analyse les actions relatives aux manuels d'enseignants (2011a, 2011b, 2015b). L'un des objectifs de ses recherches consiste à faire évoluer ces pratiques.
La recherche-action est recherche impliquée en ce que « le chercheur influe sur le cours des événements observés, qu'il le veuille ou non, des que par sa présence il indique que les événements sont sources (positivement ou négativement) d'intérêt » (Paillé: 224). Cet aspect nous le prenons constamment en compte dans nos recherches par un travail de terrain, sur le terrain ou le chercheur a agi et co-agi, l'utilisation de méthodes ethnographiques (d'observation participante et d'entretien approfondi notamment) et un travail sur l'impact du chercheur et sur les observables.
Dans le même sens, la recherche-action est recherche imbriquée, en ce que le chercheur et / ou le praticien réflexif, impliqué dans son/ses terrain(s), change et évolue relativement aux liens étroits qui l'unissent au terrain d'expérimentation. Rappelons que la recherche-action inclut plusieurs acteurs: chercheur(s) et praticien(s), dont les démarches de recherche/pratique sont croisées. Le praticien renvoie ses interrogations (propres à une démarche de recherche) sur ces pratiques mêmes. Le chercheur, quant à lui, n'est pas forcément détaché du terrain qu'il observe, il peut être aussi parallelement praticien.
Enfin, la recherche-action est engagée dans une action, par et pour l'action. Les recherches-actions s'inscrivent dans un « va-et-vient entre élaboration intellectuelle et le travail de terrain avec les acteurs » (Barbier, 1996: 86). En effet, en didactique, une recherche-action doit intégrer des échange(s) suivis de collaboration(s) avec les enseignants des situations étudiées, ce que nous sommes en train de réaliser. Dans le champ de la DDLC, Demaizière et Narcy-Combes conçoivent la recherche-action comme une recherche dans laquelle « le chercheur est partie prenante de l'action et non 'simple' observateur extérieur », les questions de recherche sont liées étroitement à une pratique pédagogique : « Le praticien chercheur de la recherche-action met en place un certain type d'environnement d'apprentissage ou de tâches ou activités » (2007: 15-16). L'acteur de la recherche (de l'action ou de l'intervention) n'est pas seulement le chercheur mais aussi l'enseignant (par exemple) lequel participe à l'élaboration de la recherche1. Sa tâche peut consister à la fois à s'investir comme acteur de terrain mais aussi à être l'observateur de sa pratique, d'où l'appellation « praticien réflexif » tel que Schön l'avait défini (dans Montagne-Macaire, 2007: 97-98). La recherche-action en DDLC se définit par :
- Une logique spiralaire,
- Un cadre d'interventions respectant certains critères,
- Plusieurs niveaux d'interventions,
- La présence et prise en compte d'acteurs et contextes,
- La posture du chercheur (Montagne-Macaire, 2007, p. 107-113).
D'autre part, intervenir signifie littéralement « venir entre » ce qui suppose un entre-deux, une zone intermédiaire ou « méso » (entre la recherche et les acteurs, la théorie et la pratique, etc.) (Resweber, 1995: 78). Cela permet de créer un « espace symbolique de négociation dans l'intervalle de la recherche et de l'intervention » (Mérini & Ponté, 2008: 90).
Relativement au rôle de l'intervention, Montagne-Macaire (2007) considère que
La recherche-action repose sur le principe d'un processus interventionniste conçu par, ou à tout le moins, avec les sujets impliqués et dont l'objectif est la modification par les praticiens de leur relation à leurs postures d'enseignement/apprentissage, voire l'évolution de ces pratiques mêmes pouvant s'étaler sur une échelle allant d'une meilleure conscience d'elles à une plus grande maîtrise, ou encore à une action sur elles en termes de modifications (p. 93).
Nous retiendrons que la recherche-action a une visée tant transformationnelle que participative (Montagne-Macaire,2007: 97). Toutefois, d'après les définitions de Paillé et Montagne-Macaire, sur lesquelles nous nous sommes appuyés, il demeure difficile de distinguer clairement l'action de l'intervention, celles-ci étant interdépendantes.
L'intervention rend compte de la valeur systémique de l'action. Pourtant, l'objectif d'une recherche-intervention n'est pas de résoudre les tensions mais plutôt de les articuler entre elles. Autrement dit, une de ses principales fonctions est plus épistémique que praxéologique (plutôt relative à la recherche-action) car il s'agit d'un travail de (re)problématisation de la situation donnée. En effet, « l'enjeu est de produire de la connaissance autour de ce qui fait crise dans le champ professionnel ou connaît une mutation dans les pratiques, mais on attend d'elle, dans le même temps, une transformation indirecte de ces pratiques » (Mérini & Ponté, 2008: 92-93). D'où l'importance consacrée à la recherche en tant que telle.
Parce que nos actions restent de l'ordre de la proposition et n'engagent pas pour l'instant une collaboration étroite et suivie avec les enseignants du terrain nos recherches ne peuvent recevoir l'appellation de recherche-action. Par contre nous qualifions, à partir de la terminologie de Pierre Paillé, nos recherches de « recherches-interventions » en ce qu'elles sont à la fois « intervention au niveau de pratiques problématiques et recherche sur ces pratiques et sur l'intervention menée » (2004: 224).
A l'instar de De Robillard, nous croyons que la qualité d'une recherche s'établit pour une grande part à partir des conséquences sur le réel2 qu'elle a eu, aura ou peut avoir. Nous rejoignons Dominique Macaire : « Contrairement au linguiste, le chercheur en DDLC ne peut s'isoler et traiter des langues hors des usages et des pratiques des apprenants ou des relations de celles-ci avec les sociétés qui les véhiculent. Il vit les tensions idéologiques et sociétales des langues et des cultures. La DDLC est un creuset formidable de regards sur les actions, les dispositifs, les individus apprenants, les situations complexes » (2010: 68).
Notre vision « utilitariste » de la recherche n'implique pas pour autant que nous disqualifiions d'autres types de recherches détachées d'un terrain, « non-utilitaristes » voire « noosphériques » (Morin, 1991), dans la sphère des idées. Nous convergeons vers les préoccupations du Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales (M.A.U.S.S., 1982, Caillé, 1989) qui n'assujettit pas la recherche à l'intérêt, la production de résultats mais défend la possibilité de recherches qu'en sciences dures on qualifierait de « fondamentales », n'ayant pas de finalités pratiques immédiates.
Aussi, des l'origine, avons-nous voulu situer nos recherches dans une perspective interventionniste par le biais de propositions d'amélioration, de changements en vue de mettre en place des interventions voire des actions (élaboration de manuels, séminaires de formations, etc). Nous avons chacun investit le champ de la sociodidactique dans des contextes différents : Damien Le Gal a mis en oeuvre une approche contextuelle, globale, de l'enseignement-apprentissage du français au Brésil au moyen d'une étude des pratiques des manuels développés par les enseignants de français (2011a, 2011b). Aujourd'hui il poursuit cette recherche en Colombie auprès des enseignants d'anglais (2015a, 2015b). Claire Vilpoux tente, quant à elle, de montrer l'évolution de l'enseignement-apprentissage du français en Ukraine par le biais de la restructuration des programmes d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur, entre autres (2016).
Nos recherches respectives s'inscrivent dans une approche semi-interventionniste (toutes les conditions pour l'intervention n'étant pas réunies) dans la mesure où elles proposent d'interpeller les praticiens en les engageant entre autres dans une conscientisation de leurs pratiques. La thèse de Damien Le Gal a formulé un ensemble de propositions pour la formation des enseignants de langue, notamment à l'usage des manuels (2011a). Aujourd'hui il transpose ces résultats dans les pratiques d'enseignants d'anglais en Colombie et dans la formation des futurs enseignants de langue. Cette thèse a également porté un ensemble de propositions pour que les manuels avancent vers plus de modularité, qu'ils évoluent sur le plan de leur forme et de leur structure organisationnelle afin de réduire leur directivité et de tendre, par leur polymorphie, à une malléabilité qui permette à l'enseignant de mieux adapter son enseignement-apprentissage.
L'approche ethno-sociodidactique a été traduite sous la forme d'un ensemble condensé de questions concrètes que les enseignants peuvent se poser pour envisager analytiquement la situation d'enseignement-apprentissage et son contexte de manière globale et complète, questionnement permettant d'élaborer un enseignement-apprentissage adapté.
Pour Claire Vilpoux (2013), son travail consiste à :
- Envisager une co-réflexivité et à engager un dialogue constructif avec les équipes pédagogiques et institutions en comparant les ressources disponibles, les besoins, les attentes et les discours des acteurs ;
- À proposer des recommandations pour un enseignement-apprentissage plus modulable et diversifié (via des formations aupres des enseignants) êt à etre consultée par la suite au profit de l'évolution du système universitaire ukrainien (2016).
Les propositions sur le plan de la formation, si elles sont développées, pourraient amener la recherche de Damien Le Gal à recevoir l'appellation de « recherche-formation ». Cette dernière désigne des recherches « dans lesquelles il y a une action délibérée de transformation de la réalité ; recherches ayant un double objectif : transformer la réalité et produire des connaissances concernant ces transformations » (Hugon & Seibel, 1988, p. 13), « la recherche, et principalement ses méthodologies, sont mises au service d'un objectif de formation » (Marcel & Rayou, 2004, p. 20).
Néanmoins, il demeure difficile, pour des recherches comme celles menées, d'avoir une intervention au-delà des propositions. Celles-ci ont eu tendance à se « disperser » en investissant différentes sujets, problématiques, ce qui ne leur a pas permis de finaliser leur projet par une intervention plus effective (une collaboration avec un auteur ou un éditeur de manuels afin de commencer à élaborer concretement un manuel « polymorphe » par exemple). D'autre part les exigences et la masse de travail requise par une recherche doctorale sont extrêmement difficiles à concilier avec une mise en oeuvre approfondie. Les recherches menées se situent plus en début des processus qu'à leur terme. Nous voulons que leur continuité nous amène à de véritables applications, changements, sur les pratiques enseignantes et leurs matériels.
Conclusion
Cet article espère avoir montré comment la didactique et la sociodidactique se présentent comme des espaces de développement de recherche-actions et de recherches-interventions. En développant ces notions, nous y avons confronté nos recherches respectives pour voir comment celles-ci s'insèrent ou non sous ces appellations.
Nous sommes conscients que notre raisonnement comporte quelques nuances qu'il reste a développer. Toutefois, nous avons voulu contribuer à alimenter le débat en abordant ces quelques notions et pratiques qui traversent désormais la recherche en (socio)didactique.
1 En guise d'exemple de recherche-actions ou interventions en DDLC, nous invitons le lecteur à consulter l'article explicatif de sa démarche d'Emmanuelle Huver (2008). « Comparons nos langues » et/ou « mobilisons nos ressources ? » Approche par scénario et insertion scolaire et sociale des enfants allophones, Glottopol, 11, 138-148, http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/telecharger/numero_11/gpl11_12huver.pdf, (Consulté le 28 janvier 2011).
2 Propos tenus lors du séminaire « L'édition scientifique à la croisée des chemins : scientificité, accessibilité, visibilité » organisé a Rennes les 17 et 18 septembre 2009 par le laboratoire PREFics EA 3207 de Rennes 2, dans le cadre et avec le soutien de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne.
Références bibliographiques
Boyer, H., Butzbach-Rivera M., & Pendanx, M. (2001). Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangere. Paris : Clé International.
Caillé, A. (1989). Critique de la raison utilitaire, manifeste du MAUSS. Paris : Éditions la Découverte.
Coste, D. (2001). De plus d'une langue à d'autres encore penser les compétences plurilingues ? Dans V. Castellotti (Dir.), D'une langue à d'autres : pratiques et représentations (pp. 191- 202). Rouen : Université de Rouen.
Demaiziere, F., & Narcy-Combes, J-P. (2007). Du positionnement épistémologique aux données de terrain. Les Cahiers de l'ACEDLE, 4. http://acedle.u-strasbg.fr/IMG/pdf/Demaiziere-Narcy_cah4.pdf, (Consulté le 12 février 2009).
Hugon, M-A. & Seibel, C. (1988). Recherches impliquées, Recherches action : Le cas de l'éducation. Bruxelles: De Boeck.
Le Gal, D. (2011a). Contextualisation didactique et usages des manuels : une approche sociodidactique de l'enseignement du Français Langue Étrangère au Brésil. Université Européenne de Bretagne- Rennes 2. tel.archives-ouvertes.fr/tel-00576486/en/
Le Gal, D. (2011b). Le manuel comme cadre d'enseignement: modalités et enjeux. Travaux de didactique du Français Langue Étrangère, 65-66, 173-186.
Le Gal, D. (2015a). English Language Teaching in Colombia: A Necessary Paradigm Shift. PROFILE Issues in Teachers' Professional Development (en révision).
Le Gal, D. (2015b). How Do Language teachers Use Their Textbooks? Manuscrit en préparation.
Marcel, J.-F., & Rayou, P. (2004). Recherches contextualisées en éducation, Paris : INRP.
M.A.U.S.S. (Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales) (1982). Bulletin du MAUSS, 1.
Merini, C., & Ponte, P. (2008). La recherche-intervention comme interrogation des pratiques, dans Savoirs, 16,
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SAVO_016_0077 (Consulté le 1er mars 2015).
Macaire, D. (2010). Monisme ou pluralisme ? Vers une conception compréhensive de la recherche-action en didactique des langues et des cultures, Recherches et Applications-Le français dans le monde, 48, 66-75.
Montagne-Macaire, D. (2007). Didactique des langues et recherche-action, ACEDLE, 4, http://acedle.org/IMG/pdf/Macaire-D_cah4.pdf, (Consulté le 02 mars 2015).
Morin, E. (1991). La méthode 4, Les idées, leur habitat, leur vie, leurs mours, leur organisation. Paris : Éditions du Seuil.
Resweber, J-P. (1995). La recherche-action. Paris : PUF.
Rispail, M. (2005). Plurilinguisme, pratiques langagières, enseignement : pour une socio-didactique des langues, Habilitation a Diriger des Recherches en Sciences du Langage, sous la direction de BLANCHET P., Université de Rennes 2 - Haute-Bretagne, Rennes.
Vilpoux, C. (2013). L'enseignement du français dans les universités en Ukraine : changements et enjeux. Dans L. Colles (Dir.) Politiques linguistiques et enseignement-apprentissage de français : quelles perspectives pour la pluralité linguistique ?, Revue Dialogues et Cultures, no 62, FIPF.
Revista Electrónica Matices en Lenguas Extranjeras, número 6. ISSN 2011-1177.
Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas - Departamento de Lenguas
Extranjeras.
Bogotá. http://revistas.unal.edu.co/index.php/male
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia
Derechos de autor 2012 Matices en Lenguas Extranjeras

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional