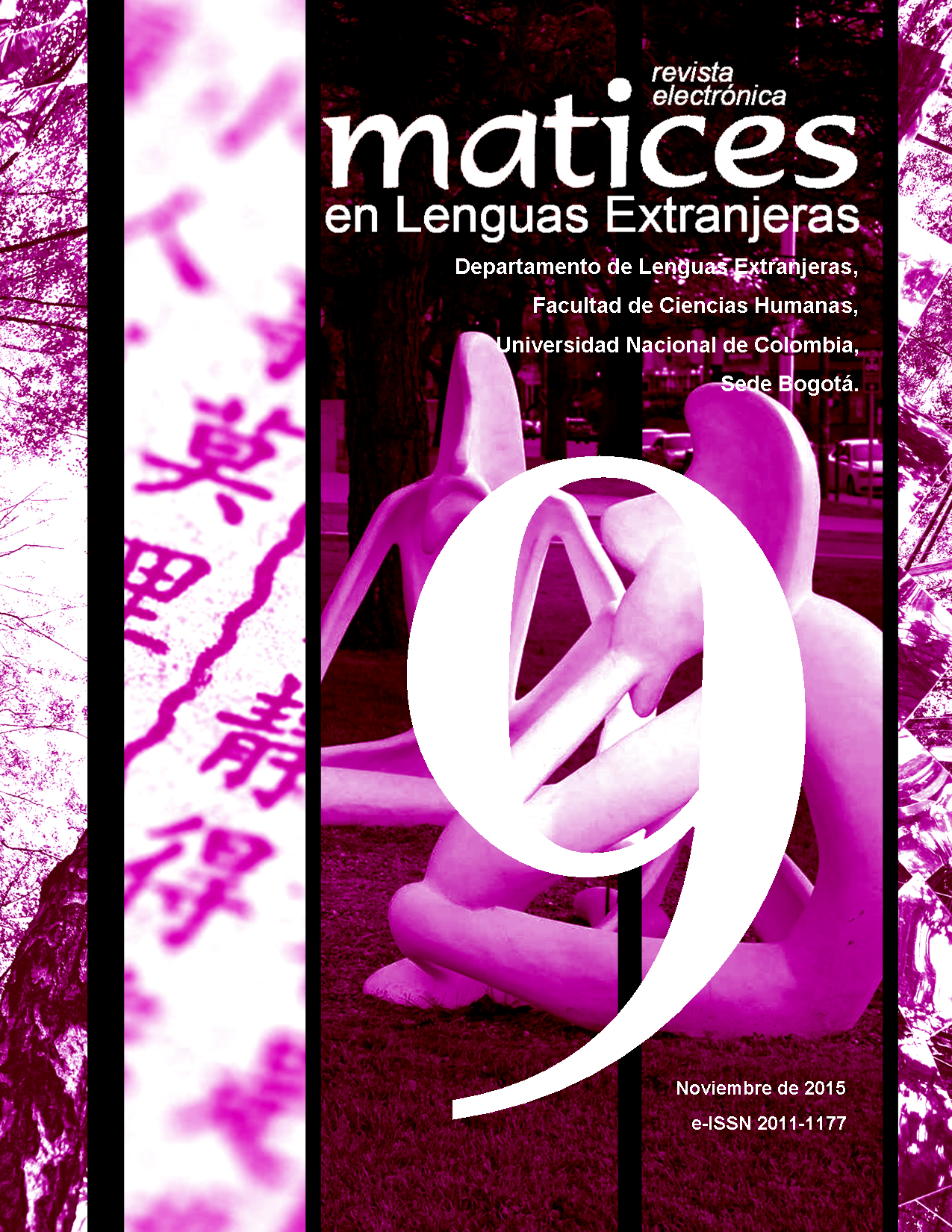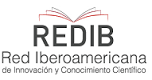De francisant à enseignant de français : réflexion sur le parcours de formation des enseignants arabophones de français langue 3
Reflections on the Training Courses of Arabic Speaking Teachers of French as a Third Language
Reflexiones sobre los cursos de formación de profesores de lengua árabe de francés como tercera lengua
DOI:
https://doi.org/10.15446/male.n9.54917Palabras clave:
francisant, francophone, apprentissage du français langue 3, formation initiale (fr)French language learner, French speaker, initial training, French as a third language (en)
francófono, aprendizaje del francés como tercera lengua, formación inicial (es)
Cet article tente de dresser un état des lieux de la formation des enseignants de fran- çais langue étrangère dans deux pays arabes à savoir la Jordanie et le Bahreïn où le français a le statut de langue 3.
Dans la Jordanie et le Bahreïn, le français est une langue étrangère enseignée comme matière optionnelle ou obligatoire dans le système scolaire et universitaire dans le cadre d’accords de coopération entre le pays d’accueil et la France.
Fort de ce constat, s’intéresser à ces enseignants en charge de la diffusion de la langue française principalement à leur formation initiale et continue mais aussi à leur propre contexte professionnel, retient notre attention. De fait, il faut souligner que nom- breux sont ces enseignants à être passés du statut de francisant à francophone en un laps de temps assez court.
Cet écrit veut également s’adresser à tous les professionnels de la diffusion du fran- çais langue étrangère qui peuvent ainsi découvrir d’autres réalités de formation universi- taires dans différents contextes éducatifs.
Cet article s’articule autour de cinq points : la présentation de ces pays arabes de tradition anglophone, l’introduction du français dans ces pays, les raisons de la diffusion de la francophonie, l’état des lieux de la formation initiale des enseignants de français en Jor- danie et au Bahreïn et la réception des formations universitaires franco-françaises pour de- venir professeur de français.
This article attempted to make an inventory regarding the initial training of teachers of French as a Foreign Language in two Arab countries, namely Jordan and Bahrain, where French is taught as a third language.
In Jordan and Bahrain, French is taught as a mandatory or non-mandatory subject in schools and universities depending on the cooperation agreements that exist between France and these two countries.
It is important that the teachers who are in charge of the spread of French language in their own countries take into account both cultural and educational backgrounds. In fact, most of them were very often new “French speakers” in so far as most of them have just learned the language during their studies at university.
This article was also addressed to all the professionals responsible for the spreading of French as Foreign language, in order to help them discover other realities of university education in different educational contexts.
This article approaches five main points: the presentation of Arab countries with Anglophone tradition, the teaching of French language in these countries, the reasons of the diffusion of the Francophonie, the initial training of French language teachers in Jordan and Bahrain and the French University training to become a French language teacher.
Este artículo realiza un estudio sobre el nivel de formación de los profesores de francés lengua extranjera en dos países árabes: Jordania y Bahréin, donde el francés se imparte como tercera lengua.
En Jordania y Bahréin, el francés se imparte en colegios y universidades tanto de forma obligatoria como optativa dependiendo de los acuerdos de cooperación que existen entre Francia y estos países.
Es importante que los profesores que están implicados en la difusión del francés en sus países de origen, tengan en cuenta tanto el trasfondo cultural como el educativo, considerando que, en este sentido, los profesores en su gran mayoría no son nativos, y han aprendido dicha lengua a través de sus estudios universitarios.
Asimismo, este artículo va dirigido a todos los profesionales encargados de la difusión del francés lengua extranjera, con el fin de que puedan descubrir otras realidades de formación universitaria en diferentes contextos educativos.
Este artículo aborda cinco puntos: la presentación de los países árabes de tradición anglófona, la enseñanza del francés en estos países, las razones de la difusión de la francofonía, la formación inicial de los docentes de francés en Jordania y Bahréin y la formación universitaria francesa para llegar a ser profesor de francés.
De francisant à enseignant de français : réflexion sur le parcours de formation des enseignants arabophones de français langue 3
Reflexiones sobre los cursos de formación de profesores de lengua árabe de francés como tercera lengua
Reflections on the Training Courses of Arabic Speaking Teachers of French as a Third Language
Carine Zanchi
zanca72@gmail.com
Professeur de français, King's Academy, Jordanie. Madaba, Jordania
Laboratoire ICAR 2
Recibido: 5 de julio de 2015
Aprobado: 20 de diciembre de 2015
Résumé
Cet article tente de dresser un état des lieux de la formation des enseignants de français langue étrangère dans deux pays arabes à savoir la Jordanie et le Bahreïn où le français a le statut de langue 3.
Dans la Jordanie et le Bahreïn, le français est une langue étrangère enseignée comme matière optionnelle ou obligatoire dans le système scolaire et universitaire dans le cadre d’accords de coopération entre le pays d’accueil et la France.
Fort de ce constat, s’intéresser à ces enseignants en charge de la diffusion de la langue française principalement à leur formation initiale et continue mais aussi à leur propre contexte professionnel, retient notre attention. De fait, il faut souligner que nombreux sont ces enseignants à être passés du statut de francisant à francophone en un laps de temps assez court.
Cet écrit veut également s’adresser à tous les professionnels de la diffusion du français langue étrangère qui peuvent ainsi découvrir d’autres réalités de formation universitaires dans différents contextes éducatifs.
Cet article s’articule autour de cinq points : la présentation de ces pays arabes de tradition anglophone, l’introduction du français dans ces pays, les raisons de la diffusion de la francophonie, l’état des lieux de la formation initiale des enseignants de français en Jordanie et au Bahreïn et la réception des formations universitaires franco-françaises pour devenir professeur de français.
Mots-clés : francisant, francophone, apprentissage du français langue 3, formation initiale.
Resumen
Este artículo realiza un estudio sobre el nivel de formación de los profesores de francés lengua extranjera en dos países árabes: Jordania y Bahréin, donde el francés se imparte como tercera lengua.
En Jordania y Bahréin, el francés se imparte en colegios y universidades tanto de forma obligatoria como optativa dependiendo de los acuerdos de cooperación que existen entre Francia y estos países.
Es importante que los profesores que están implicados en la difusión del francés en sus países de origen, tengan en cuenta tanto el trasfondo cultural como el educativo, considerando que, en este sentido, los profesores en su gran mayoría no son nativos, y han aprendido dicha lengua a través de sus estudios universitarios.
Asimismo, este artículo va dirigido a todos los profesionales encargados de la difusión del francés lengua extranjera, con el fin de que puedan descubrir otras realidades de formación universitaria en diferentes contextos educativos.
Este artículo aborda cinco puntos: la presentación de los países árabes de tradición anglófona, la enseñanza del francés en estos países, las razones de la difusión de la francofonía, la formación inicial de los docentes de francés en Jordania y Bahréin y la formación universitaria francesa para llegar a ser profesor de francés.
Palabras clave: francófono, aprendizaje del francés como tercera lengua, formación inicial.
Abstract
This article attempted to make an inventory regarding the initial training of teachers of French as a Foreign Language in two Arab countries, namely Jordan and Bahrain, where French is taught as a third language.
In Jordan and Bahrain, French is taught as a mandatory or non-mandatory subject in schools and universities depending on the cooperation agreements that exist between France and these two countries.
It is important that the teachers who are in charge of the spread of French language in their own countries take into account both cultural and educational backgrounds. In fact, most of them were very often new “French speakers” in so far as most of them have just learned the language during their studies at university.
This article was also addressed to all the professionals responsible for the spreading of French as Foreign language, in order to help them discover other realities of university education in different educational contexts.
This article approaches five main points: the presentation of Arab countries with Anglophone tradition, the teaching of French language in these countries, the reasons of the diffusion of the Francophonie, the initial training of French language teachers in Jordan and Bahrain and the French University training to become a French language teacher.
Keywords: French language learner, French speaker, initial training, French as a third language.
A l’heure de la mondialisation et de la prédominance de l’anglais comme langue internationale d’enseignement, l’on estime cependant que sur 193 pays inscrits à l’ONU (Organisation des Nations Unies), plus de 132 sont homologués comme disposant de capacités à enseigner le français. Il y a actuellement plus de 900 000 professeurs de français répartis sur les 5 continents. L’enseignement du français se fait dans un contexte plurilingue. De fait, en raison du statut de cette langue qui varie selon les pays, la formation initiale des enseignants de français est très diverse. En effet, il est intéressant de constater que dans les pays où le français a le statut de langue 3 comme c’est le cas au Proche et Moyen-Orient, les enseignants sont soit des anciens francisants / francophones partiels soit de nouveaux francophones qui ont choisi d’étudier le français à l’université dans le cadre du programme d’études françaises.
Ce contact récent avec la langue française et l’exposition limitée au français sont des données à prendre en compte. De plus, peu d’étudiants avaient la possibilité de poursuivre leurs études en Licence ou en Master en raison de l’absence sur place de formations.
C’est pour cette raison que les services français de coopération des ambassades de France essaient de mettre en place des formations de Licence et Master dans le cadre d’accords de coopération entre universités françaises et universités arabes. Outre un état des lieux des formations initiales existantes (Bahreïn et Jordanie), nous tenterons dans cet article de faire le point sur la réception des formations universitaires franco-françaises (Sciences du langage) chez des étudiants arabophones afin d’évoquer le problème de transfert de connaissances chez ces étudiants habitués à d’autres discours didactiques et universitaires.
Des pays arabes de tradition anglophone
Comme l’a mentionné le rapport du ministère français des Affaires étrangères (Journal du Sénat, 20001):
(...) L'attrait pour la France est fort dans l'ensemble de la zone (Maghreb et Levant), y compris dans l'ancienne sphère d'influence britannique (Palestine, Egypte, Jordanie et Irak) et dans la péninsule Arabique.
Au Proche et Moyen-Orient à l’exception du Liban, le français a le statut de langue 3. Dans ces pays arabophones, l’arabe est la langue officielle mais elle n’est pas la langue maternelle de tous les habitants du fait de la présence de nombreuses minorités ethniques à savoir pour la Jordanie (les Arméniens, les Tchétchènes, les Circassiens et Tcherkesses) et pour le Bahreïn (des descendants d’Iraniens et autres nationalités non arabes qui ont accédé à la naturalisation bahreïnienne). Ces pays ont été aux XIXe et XXe siècles sous le protectorat anglais et sont de fait des pays anglophones où l’anglais a un statut privilégié. Officiellement, il est la première langue étrangère. Il faut cependant apporter quelques nuances à ce statut qui diffère en fonction des milieux socioprofessionnels. En effet, deux systèmes d’éducation coexistent : le public où l’arabe est la langue d’enseignement et le privé avec pour langue d’enseignement l’anglais.
L’anglais est donc la langue véhiculaire avec des fonctions socio-économiques et éducatives. Les attitudes sociales envers l’anglais sont très positives. En effet, cet attrait pour l’anglais est perçu comme une volonté de distanciation vis-à-vis de l’arabe considéré comme la langue populaire.
Le français au Proche et Moyen-Orient : une introduction an-cienne et récente
Le français a le statut de langue 3. En vertu des accords signés entre la France et ces deux pays arabophones, le français est une langue étrangère introduite comme matière optionnelle dans le système scolaire principalement au collège. La diffusion de cette langue est le produit d’une réalité historique plurielle où les aspects politiques y tiennent une place considérable. En effet, le français était présent au Proche-Orient plus précisément au Liban et en Palestine mandataire dès les années 1880 principalement avec la présence dans le système éducatif des écoles missionnaires françaises (Les sœurs de Saint Joseph et les frères des écoles chrétiennes etc.) où le français occupait le statut de première langue étrangère et de langue courante d’enseignement au détriment de l’arabe (Sanchez-Summerer, 2009, p.111).
Selon Sanchez-Summerer (2006) qui retrace l’histoire du français en Terre Sainte, le français était perçu comme un instrument de culture durant la période ottomane et pendant les premières années du mandat britannique sur la Palestine :
Chez les non-musulmans, le français est langue de protection et d’éducation, chez les musulmans, le français est indispensable de faire carrière à l’intérieur du système ottoman car c’est la deuxième langue d’administration de l’empire ». La Palestine avant le mandat britannique avait un statut de la « plus française des terres d’Orient (p.102).
Ce rappel historique explique a fortiori pourquoi cette perception du français comme langue de culture et de distinction prévaut encore de nos jours au sein de la population jordanienne. Lors de la création de l’Etat d’Israël et des conflits israélo-arabes qui s’ensuivent, les autorités chrétiennes ont décidé d’ouvrir de nouvelles écoles religieuses en Jordanie. De fait, ces écoles religieuses ont importé leur système éducatif dans ce pays tout en se conformant aux directives du nouvel Etat jordanien qui accordait une place importante à l’arabe comme langue d’enseignement.
De nos jours, les écoles religieuses proposent toujours des cours de français précoce. Ces écoles même si elles sont ouvertes aux autres communautés religieuses, sont avant tout des écoles confessionnelles pour l’éducation des minorités chrétiennes. Le trilinguisme arabe-anglais et français est favorisé.
Par conséquent, les Palestiniens / Jordaniens ayant fréquenté ces écoles ont appris la langue française dès leur plus jeune âge jusqu’au baccalauréat. Les Jordaniens ont un très bon niveau en français. Ceci explique pourquoi dans la société jordanienne, la langue française est vue comme « une langue littéraire et culturelle, de prestige, des élites à laquelle s’attachent les intellectuels » (Al Rabadi, 2004, p.42).
Promotion de la francophonie dans ces pays arabophones
Selon le rapport de l’organisme international de la francophonie (2005, p.111), le français se taille une place croissante (voir Tableau 1) dans l’enseignement car il apparait de plus en plus nettement aux yeux des autorités et du public comme une « langue de démarcation à maîtriser en plus de la langue véhiculaire que constitue l’anglais ». A l’instar des autres pays du Proche et Moyen-Orient, l’enseignement du français en Jordanie et au Bahreïn est en constante augmentation, ce qui montre la progression de la francophonie dans les pays arabophones de tradition anglophone. Cette augmentation de francophones s’explique pour plusieurs raisons. La première par la politique menée par les ambassades françaises en place dont la tâche est de promouvoir l’apprentissage / enseignement du français. La deuxième est liée à la politique jugée pro-arabe de la France appréciée par ces pays.
Au Bahreïn, le français est une matière optionnelle dans l’enseignement secondaire. En Jordanie, il représente la deuxième langue étrangère enseignée par 250 professeurs dans 170 établissements, publics et privés, en tant que matière facultative à environ 43 000 élèves. Cette diffusion du français nécessite des professeurs formés2.
Comme l’indiquent les chiffres ci-dessous, l’enseignement du français est en constante augmentation et par conséquent, il existe une population francophone répartie entre « francophones réels » et « francophones partiels » (voir Tableau 2).
Il nous faut signaler que ces terminologies ont été remplacées par de nouvelles définitions. En effet, depuis 2002, suite à la mise en place d’un groupe de travail par le Haut Conseil de la Francophonie avec l’Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), et sur suggestion du linguiste Chaudenson R., l’on parle de « francophones » et « francophones partiels ». Le terme « francophone » désigne une personne capable de faire face, en français, aux situations de communication courante tandis qu’un « francophone partiel » est une personne ayant une compétence réduite en français, lui permettant de faire face à un nombre limité de situations.
Au Proche et Moyen-Orient, l’on dénombrait ainsi en 2002 environ 1 818 000 millions de francophones et plus de 783 000 millions de francophones partiels. Néanmoins, ces chiffres ne prennent pas en compte le nombre de « francisants » qui désignent les étudiants apprenant le français : « ont appris le français pendant plusieurs années et en ont gardé une maîtrise variable, ou qui sont amenés à le pratiquer, même partiellement, pour leur métier. » (OIF, 2014). Il est manifeste que le nombre de francisants est supérieur à celui des francophones et francophones partiels.
Etat des lieux de la formation initiale des enseignants de français en Jordanie et au Bahreïn
Au Proche et Moyen-Orient, les professeurs de français langue étrangère jouent un rôle très important dans la diffusion de la francophonie et c’est grâce à leur travail que l’on dénombre une progression du nombre de locuteurs francophones. Les caractéristiques de ce public d’enseignants sont révélatrices de cette francophonie plurielle. Sociologiquement, à leur entrée à l’université, les futurs professeurs de FLE ont différents parcours derrière eux : francophones ayant appris le français de la maternelle au lycée (dans les écoles religieuses ou françaises), francisants voire francophones partiels ayant commencé leur apprentissage de la langue pendant leur cursus scolaire mais aussi non locuteurs francophones qui ont choisi d’apprendre le français à l’université dans le cadre des diplômes en langue et littérature françaises proposés par les universités locales. Cette diversité des parcours des enseignants de FLE témoigne de la vitalité de la francophonie en terres arabophones.
Cependant, il faut signaler que même si le français jouit d’un certain prestige comme mentionné précédemment, les études en langue et littérature françaises ne séduisent pas tellement les étudiants en raison du manque de débouchés professionnels. En effet, en raison de la prédominance de l’utilisation de l’anglais sur le marché du travail, des études en langue et littérature françaises ne favorisent pas l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Par conséquent, les étudiants qui s’inscrivent dans les programmes de français le font soit par choix soit par manque d’option faute d’avoir été acceptés dans d’autres facultés.
Il est important de signaler que ces étudiants s’inscrivent dans une culture éducative avec ses propres caractéristiques. En effet, selon Pochard (1999) :
Les enseignants-chercheurs impliqués dans les programmes de formation de filières spécialisées : départements ou facultés d'éducation, écoles normales (supé-rieures), instituts universitaires de formation des maîtres, etc. ont vocation à produire des discours didactiques. Du fait, de leur ancrage institutionnel, au sein d'un système éducatif donné (il s'agit de produire des enseignants « nationaux »), les problématiques de ces didacticiens sont fortement marquées et délimitées par les contraintes propres aux situations locales.
En Jordanie
Quelques universités publiques offrent des formations de type Licence ou B.A dans le cadre de programmes « Langue et littérature françaises ». Les étudiants non francophones ont la possibilité de débuter leur apprentissage de la langue française à l’université et de se perfectionner en français tout au long de leurs années d’études pour passer ainsi des statuts de francisant, de francophone partiel à celui de francophone. A la fin de leur cursus en licence, les étudiants futurs professeurs sont censés avoir le niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR).
Suite à l’arrêt du programme de bourses accordées par l’ambassade de France, peu d’étudiants ont la possibilité de faire des stages de perfectionnement en France ou dans un pays francophone. En contexte hétéroglotte, l’apprentissage / enseignement du français s’effectue exclusivement en interaction entre enseignant et élève dans un espace clos : la classe. La communication est de type exolingue.
Lors de ces deux dernières années, des programmes de Master ont vu le jour pour mieux valoriser les études en français mais aussi pour une meilleure insertion professionnelle des étudiants inscrits dans ces programmes. A l’université du Yarmouk, depuis 2011, un master de Sciences du langage / langue française3 est actuellement offert dans le cadre d’une convention signée avec l’université de Nantes. Cet accord prévoit de mettre en place des échanges réguliers entre les universités de Nantes et du Yarmouk (étudiants et professeurs) et l’organisation de conférences et de colloques. A l’université de Jordanie, un master de traduction français / arabe4 a également vu le jour récemment.
En Jordanie, la formation universitaire est donc locale avec des curricula conçus localement et approuvés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche dont le principal souci est d’aider les jeunes diplômés à trouver des débouchés professionnels. Cette formation universitaire tient compte du profil des étudiants. Même si le français est la langue d’enseignement, l’arabe est la langue d’accompagnement universitaire. Ces cours universitaires sont enseignés principalement par des professeurs arabophones titulaires de doctorats en Sciences du langage obtenus dans des universités soit françaises soit francophones.
Selon Al Rabadi (2004), les problèmes rencontrés pour les francophones jordaniens mais valables pour les francophones bahreïniens, sont les suivants :
- L’absence d’environnement francophone : le manque de pratique de la langue française est un réel problème pour ces professeurs.
- Le faible recrutement des professeurs de français donc peu de débouchés professionnels pour les filières de français.
- Le manque de professeurs compétents ou bien formés.
- La poursuite des études de doctorat5 dans un pays francophone qui sont coûteuses pour les étudiants comme pour leurs familles (p. 43).
Au Bahreïn
La situation est toute autre puisque le français n’est enseigné que comme matière optionnelle à l’université de Bahreïn (UOB)6, comme dans les autres universités privées du Royaume. Par conséquent, les étudiants bahreïniens désireux de devenir professeurs de français sont obligés de quitter Bahreïn pour entamer des études en français. Ils ont par la suite la possibilité de finir leur cursus universitaire à distance au Bahreïn avec le centre de Télé-enseignement de l’université de Rouen (CTEUR).
Jusque dans les années 2005, il existait l’équivalent d’un diplôme DEUG7 d’études françaises à l’UOB dans le cadre d’accords de coopération entre l’UOB et l’université de Franche-Comté. Les meilleurs étudiants inscrits au diplôme de français étaient sélectionnés pour continuer leurs études en France au Centre de linguistique appliquée (CLA) dans le cadre d’un programme de bourse financé par l’ambassade de France de Bahreïn.
L’ambassade de France de Bahreïn dans un souci de massification de l’accès à la licence de français, seul diplôme reconnu par le ministère bahreïnien de l’éducation nationale pour le recrutement de professeur de FLE, a proposé dès 2003, des formations à distance en Sciences du langage dans le cadre d’accords bipartites entre le CTEUR et l’ambassade de France. Or, avec la fermeture définitive du DEUG en études françaises à l’UOB, ces formations destinées initialement aux étudiants de l’UOB dans le cadre de la formation initiale, ont changé de public d’étudiants. Elles s’inscrivent maintenant dans le cadre de la formation continue des enseignants de FLE, et elles s’adressent principalement à des professeurs de FLE bahreïniens ou étrangers.
Réception de ces formations universitaires franco-françaises
Pour les étudiants jordaniens, même si les formations sont locales, il n’empêche que seule l’obtention du Delf B2 (voir Tableau 3) leur permet d’être acceptés en Master.
Quant aux étudiants bahreïniens, ils peuvent suivre des formations en sciences du langage proposées par le département des Sciences du langage et de la communication (DESCILAC) du CTEUR8. Pour les étudiants non titulaires du Delf B2, ils doivent au préalable passer le Test de connaissance du français pour la demande d’admission préalable9 (TCF DAP) pour justifier leurs compétences linguistiques en français. Le DESCILAC propose des formations qui vont du Certificat d’Aptitude à l’enseignement du français langue étrangère (CAPEFLE : diplôme d’université équivalent à un DEUG), au Master en Sciences du langage mention FLE.
Lors de nos précédentes fonctions, nous avons pu constater que la réception de ces formations universitaires franco-françaises s’avérait une source de difficultés pour des étudiants issus d’une autre culture universitaire propre à leur culture éducative d’origine. Le problème de ces formations universitaires franco-françaises est double.
Premièrement, ce sont des formations à distance, formule d’enseignement assez méconnue les cultures d’apprentissage de ces deux pays, le professeur joue un rôle incontournable dans la transmission du savoir. Par ailleurs, le problème du manque d’autonomie est récurrent et peut avoir des conséquences négatives comme l’abandon des études.
Deuxièmement, le contenu pédagogique des cours n’est pas toujours accessible à nos étudiants qui n’ont pas les prérequis nécessaires en terme linguistique, universitaire et professionnel pour suivre ces formations (Zanchi, 2003). Les étudiants se trouvent confrontés à des chocs interdidactiques. Ces cours qui ne sont plus des cours linguistiques mais des cours théoriques enseignés à distance, sont jugés difficiles. L’autre difficulté concerne l’évaluation pratiquée par les universités françaises qui s’inscrit dans la tradition universitaire franco-française et qui ne correspond pas à la culture évaluative de nos apprenants.
Devant les difficultés des étudiants bahreïniens et les risques d’abandon, l’ambassade de France, par le biais de son attachée de coopération pour le français, a décidé de mettre en place des cours de tutorat offerts dans un premier temps en présentiel et confiés à un professeur natif qualifié en Sciences du langage et connaissant le système universitaire français. Ensuite, dans un deuxième temps, dans le cadre d’un partenariat tripartite entre le CTEUR de Rouen, l’Ambassade de France et l’Arab Open University de Bahreïn (AOU), la plate-forme de l’AOU, l’Arab Campus a proposé d’héberger les cours de l’Université de Rouen ainsi que des cours de tutorats pour faciliter l’apprentissage des étudiants et leur réussite aux diplômes de l’Université de Rouen (Certificat d’aptitude à enseigner le français langue étrangère (FLE), Licence de FLE et Master 1 et 2 de FLE). Grâce au financement d’un projet de création d’activités collaboratives en ligne, les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) ont été utilisées pour élargir le tutorat à tous les inscrits au DESCILAC résidant à Bahreïn, pour un meilleur accompagnement universitaire et surtout pour une meilleure compréhension des cours et de leurs contenus. Avec ces activités collaboratives, la transposition didactique (Chevallard, 1985) a été repensée et adaptée à notre public d’étudiants (voir Figure 1). Le but étant de rendre accessible un contenu spécifique à un profil d’étudiants précis. Ce savoir à enseigner a subi un ensemble de transformations adaptatives qui l’ont rendu apte à prendre sa place parmi les objets d’enseignements.
A l’initiative de Mangiante et Parpette (2004), un nouveau concept a commencé à gagner du terrain dans les milieux didactiques à savoir le français sur objectifs universitaires (FOU). Il s'agit d'une spécialisation au sein du français sur objectifs spécifiques (FOS) visant à préparer des étudiants étrangers à suivre soit des études universitaires dans des pays francophones soit des formations universitaires franco-françaises à distance. Avec le FOU, l’on cible les besoins d’un public d’apprenants précis soit des étudiants étrangers dans une situation d’enseignement particulière à savoir le contexte universitaire avec un contenu d’enseignement particulier : le discours universitaire. Le but étant d’aider ces futurs étudiants à poursuivre leurs études grâce à un programme d’intégration dans le système universitaire français.
Conclusion
Au Proche et Moyen-Orient, le français a le statut de langue 3. Comme le montrent les rapports de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), la francophonie s’affirme comme « une ligne de démarcation » face à l’anglais. Ceci se traduit sur le terrain par une augmentation de locuteurs francophones. Or, être francophone revêt plusieurs significations, cela peut désigner un francisant, un francophone partiel et enfin un francophone (niveau B2).
L’enseignement / apprentissage du français langue étrangère au Proche et Moyen-Orient repose principalement sur des professeurs locaux qui pour des raisons personnelles ou socio-affectives ont choisi de devenir francophone à un moment de leur vie.
La Jordanie de par son introduction ancienne du français dans son système éducatif, propose ses propres formations initiales pour former ses professeurs de français grâce à des formations universitaires locales conçues au regard de sa propre culture universitaire. Ceci montre l’intérêt déjà ancien porté par la Jordanie à la diffusion du français comme langue étrangère.
Au Bahreïn, la politique est tout autre puisque le français, matière d’enseignement récemment introduite, n’est enseigné que comme matière optionnelle au lycée comme à l’université. Par conséquent, afin de promouvoir la diffusion du français mais également pour combler l’absence de formation initiale des professeurs de FLE au Bahreïn, l’ambassade de France s’est vue obliger de prendre en charge la formation des professeurs en leur offrant des formations universitaires franco-françaises à distance. Devant les difficultés de réception dues à ce transfert universitaire, il a fallu procéder à des ajustements. Comme le montre l’exemple de création d’activités collaboratives ci-joint en Annexe, la transposition didactique a été repensée afin de mieux cibler notre profil d’étudiants, sa culture éducative et universitaire mais également ses besoins universitaires.
A l’instar d’autres contextes où le français a le statut de langue 3, les étudiants futurs professeurs et les professeurs de français en poste sont peu exposés au français (langue-culture) qui est confiné à l’intérieur de la salle de classe avec des contraintes horaires et matérielles. En fonction de la politique menée par les ambassades de France et des autres pays francophones, l’agenda culturel francophone varie d’un pays à l’autre. Par ailleurs, ces professeurs de FLE ne peuvent enseigner le français qu’à des niveaux élémentaires (A1 ou A2).
Depuis une dizaine d’années des associations de professeurs de français ont vu le jour mais elles offrent peu d’opportunités de pratiquer la langue à un niveau avancé. Ces associations permettent cependant d’assurer la formation continue des professeurs de FLE en organisant des journées thématiques de formation en didactique du FLE. Pour les professeurs plus fortunés, ils peuvent partir se perfectionner en France soit sur leurs propres deniers soit quand c’est possible dans le cadre de bourses de perfectionnement linguistique offertes par l’ambassade de France.
Enfin, avec ses différents aspects, la francophonie existe et continue à se diffuser de par le monde grâce au travail quotidien des professeurs locaux, qui ont choisi le métier de professeurs de FLE et qui sont de fait, les vrais acteurs de la francophonie.
1 http://agora- 2.org/francophonie.nsf/Documents/Arabofrancophonie-- Diffusion_de_la_langue_francaise_dans_les_pays_arabes_par_Ministere_des_Affaires_etrangeres_de_France
2 Le diplôme requis pour être recruté est la licence.
3 http://cartographie.auf.org/formations/649 (Consulté le 26 novembre 2014).
4 http://cartographie.auf.org/formations/2376 (Consulté le 26 novembre 2014).
5 Diplôme permettant d’être recruté à l’université et jouissant d’un grand prestige social.
http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/delfdalf/documents/DELF_B2.pdf (Consulté le 25/11/2014).
6 Université publique.
7 Diplôme d'études universitaires générales. Le DEUG est un diplôme universitaire de 1er cycle. Il se prépare en 2 ans. Aujourd'hui, le DEUG est intégré à la Licence comme un Bac+2.
8 http://www.univ-rouen.fr/1118154289511/0/fiche_document/ (Consulté le 26 novembre 2014).
9 http://www.ciep.fr/en/tcfdap/ (Consulté le 26 novembre 2015).
Références
Al Rabadi E., (2004). Le français en Jordanie : statut, rôle et image. In : Al Balawi Ebrahim coord., Recherches interdisciplinaires en langue-culture française dans les pays arabes, Synergies Monde arabe, n° 1, 37-44.
Chevallard Y., (1991). La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble : La pensée Sauvage.
La Francophonie dans le monde 2002-2003, OIF-Conseil consultatif, Larousse, Paris, juin 2003, 319 p.
La Francophonie dans le monde 2004-2005, OIF-Conseil consultatif, Larousse, Paris, juin 2005.
Mangiante Ch., et Parpette C., (2004). Le Français sur objectif spécifique : de l'analyse des besoins à l'élaboration d'un cours, Paris : Hachette.
Medoukh Z., (2008). Les représentations du français chez les étudiants palestiniens. Repéré.à. http://eprints.aidenligne-francaisuniversite.auf.org/24/1/pdf_Ziad_Medoukh_Representation.pdf. (Consulté le 13 août 2011).
Rapport OIF (2005). Haut Conseil de la Francophonie, La Francophonie dans le monde 2004 - 2005, Ed. Larousse, Paris.
Sanchez-Summerer K., (2006). « Langue(s) et religion(s) en Palestine mandataire au sein d’institutions éducatives catholiques : établissements des Frères des écoles chrétiennes et sœurs de Saint Joseph de l’apparition 1922-1940 p.p. 93-132 dans documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde Langue(s) et religion(s) : une relation complexe dans l’enseignement du français hors de France XVIe-XXe siècle, revue semestrielle publiée par la SIHFLES (Société internationale pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde), décembre 2006, n°37, n° édité par M-C Kok Escalle et M. van Strien-Chardonneau.
Sanchez-Summerer K., (2009). « Les langues entre elles dans la Jérusalem ottomane (1880-1914). Les écoles missionnaires françaises », Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde [En ligne], 43 | 2009, mis en ligne le 16 janvier 2011, URL : http://dhfles.revues.org/864 (Consulté le 13 août 2011).
Pochard J-C., (1999). « Didactique(s) des langues, politique(s) linguistique(s) et système éducatifs », communication au Colloque international de didactique des langues, ACEDLE, « La didactique des langues dans l'espace francophone », 5, 6 novembre 1999, université de Grenoble III, IUFM de Grenoble, Actes publiés sous la direction de D. L. Simon, J. Billiez, 2000, Grenoble, P.U.G.
Porquier R., et Py B., (2004). « Apprentissage d'une langue étrangère : contextes et dis cours », Paris : Didier.
Wolff A., (2010). La langue française dans le monde, éditions Nathan : Paris. Repéré à http://www.francophonie.org/IMG/pdf/langue_francaise_monde_integral.pdf
(Consulté le 26 novembre 2014).
Zanchi C., (2003). Rapport d’expertise : expertise du Certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement du français langue étrangère (CAPEFLE) proposé par le DESCI LAC par l’intermédiaire du centre de Télé-enseignement de l’université de Rouen, sous la direction de Claude Le Ninan, DESS Acteur international dans le domaine des langues, Centre de linguistique appliquée-Université de Franche-Comté.
Sitographie
- http://cartographie.auf.org/formations/649 (Consulté le 26 novembre 2014).
- http://cartographie.auf.org/formations/2376 (Consulté le 26 novembre 2014).
- http://agora-2.org/francophonie.nsf/Documents/Arabofrancophonie--Diffusion_de_la_langue_francaise_dans_les_pays_arabes_par_Ministere_des_Affaires_etrangeres_de_France (Consulté le 26 novembre 2014).
Annexe
Activité collaborative AOU - Fait par Zanchi C. (2006).
Cours de tutorat CAPEFLE : Approche de la civilisation française à travers la presse (CTEUR /2005).
Revista Electrónica Matices en Lenguas Extranjeras, número 9. ISSN 2011-1177.
Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas - Departamento de Lenguas
Extranjeras.
Bogotá. http://revistas.unal.edu.co/index.php/male
Referencias
Al Rabadi E., (2004). Le français en Jordanie : statut, rôle et image. In : Al Balawi Ebrahim coord., Recherches interdisciplinaires en langue-culture française dans les pays arabes, Synergies Monde arabe, n° 1, 37-44.
Chevallard Y., (1991). La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble : La pensée Sauvage.
La Francophonie dans le monde 2002-2003, OIF-Conseil consultatif, Larousse, Paris, juin 2003, 319 p.
La Francophonie dans le monde 2004-2005, OIF-Conseil consultatif, Larousse, Paris, juin 2005.
Mangiante Ch., et Parpette C., (2004). Le Français sur objectif spécifique : de l'analyse des besoins à l'élaboration d'un cours, Paris : Hachette.
Medoukh Z., (2008). Les représentations du français chez les étudiants palestiniens. Repéré.à. http://eprints.aidenligne-francaisuniversite.auf.org/24/1/pdf_Ziad_Medoukh_Representation.pdf. (Consulté le 13 août 2011).
Rapport OIF (2005). Haut Conseil de la Francophonie, La Francophonie dans le monde 2004 - 2005, Ed. Larousse, Paris.
Sanchez-Summerer K., (2006). « Langue(s) et religion(s) en Palestine mandataire au sein d’institutions éducatives catholiques : établissements des Frères des écoles chrétiennes et sœurs de Saint Joseph de l’apparition 1922-1940 p.p. 93-132 dans documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde Langue(s) et religion(s) : une relation complexe dans l’enseignement du français hors de France XVIe-XXe siècle, revue semestrielle publiée par la SIHFLES (Société internationale pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde), décembre 2006, n°37, n° édité par M-C Kok Escalle et M. van Strien-Chardonneau.
Sanchez-Summerer K., (2009). « Les langues entre elles dans la Jérusalem ottomane (1880-1914). Les écoles missionnaires françaises », Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde [En ligne], 43 | 2009, mis en ligne le 16 janvier 2011, URL : http://dhfles.revues.org/864 (Consulté le 13 août 2011).
Pochard J-C., (1999). « Didactique(s) des langues, politique(s) linguistique(s) et système éducatifs », communication au Colloque international de didactique des langues, ACEDLE, « La didactique des langues dans l'espace francophone », 5, 6 novembre 1999, université de Grenoble III, IUFM de Grenoble, Actes publiés sous la direction de D. L. Simon, J. Billiez, 2000, Grenoble, P.U.G.
Porquier R., et Py B., (2004). « Apprentissage d'une langue étrangère : contextes et dis cours », Paris : Didier.
Wolff A., (2010). La langue française dans le monde, éditions Nathan : Paris. Repéré à http://www.francophonie.org/IMG/pdf/langue_francaise_monde_integral.pdf
(Consulté le 26 novembre 2014).
Zanchi C., (2003). Rapport d’expertise : expertise du Certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement du français langue étrangère (CAPEFLE) proposé par le DESCI LAC par l’intermédiaire du centre de Télé-enseignement de l’université de Rouen, sous la direction de Claude Le Ninan, DESS Acteur international dans le domaine des langues, Centre de linguistique appliquée-Université de Franche-Comté.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Derechos de autor 2015 Matices en Lenguas Extranjeras

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional