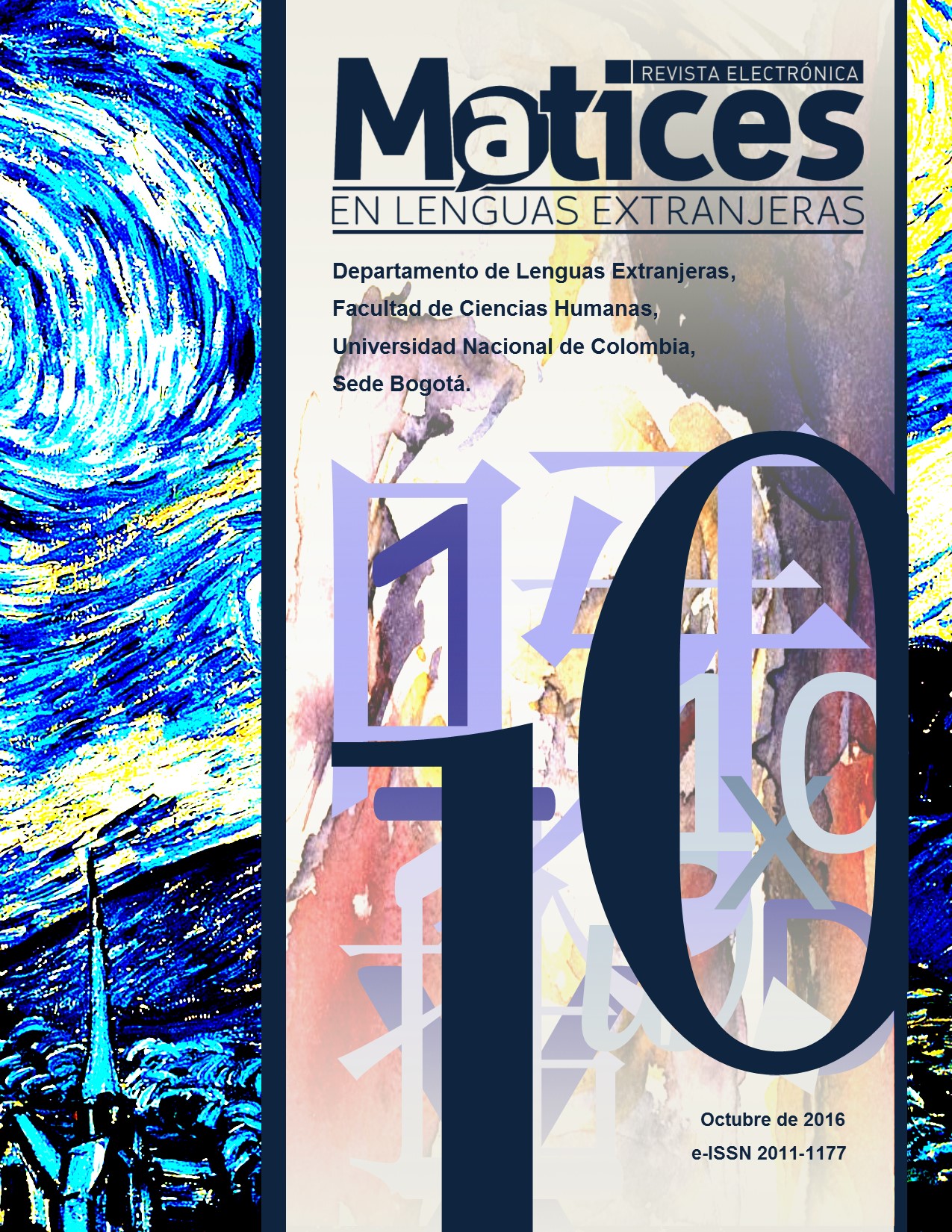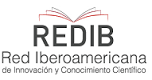La lecture critique pour développer les processus cognitifs chez des étudiants universitaires de FLE niveau B2, une étude qualitative
Critical Reading as a Strategy to Develop Cognitive Processes among FLE B2 Undergraduate Students at a Public University: A Qualitative Study
La lectura crítica como estrategia para el desarrollo de los procesos cognitivos de estudiantes de FLE nivel B2 de una universidad pública, un estudio cualitativo
DOI:
https://doi.org/10.15446/male.n10.55226Palabras clave:
processus cognitifs, lecture critique, compétence communicative, stratégies. (fr)procesos cognitivos, lectura crítica, competencia comunicativa, estrategias (es)
cognitive processes, critical reading, communicative competence, strategies (en)
Descargas
Parmi les capacités permettant à l’être humain de se former intégralement, il y a sa compréhension de la réalité et son adaptation à cette réalité pour ensuite la transformer; mais pour que ces actions soient réalisées, l'application des processus cognitifs est nécessaire. Dans ce contexte, le but de cette étude a été de mettre en place la lecture critique comme un mécanisme qui permet aux étudiants de niveau B2 de développer leurs capacités intellectuelles et en même temps d'enrichir leur compétence communicative. Parmi les instruments employés pour la collecte de données, on peut trouver des observations directes et participantes, des entretiens, des questionnaires, des tests, des notes et des ateliers. L’analyse de l’information a été faite en mobilisant la technique inductive avec les résultats suivants : les processus cognitifs les plus impliqués dans la lecture critique, les moyens ou stratégies utilisés par les étudiants pour arriver à une analyse profonde du texte et les bénéfices d’une lecture dirigée vers la pensée critique.
Entre las capacidades que permiten al ser humano formarse integralmente están la comprensión de la realidad y su adaptación a ella, para después transformarla; pero para que estas acciones puedan llegar a ser efectuadas, la aplicación de los procesos cognitivos es imperativa. En esta medida, el objetivo de este estudio es implementar la lectura crítica como un mecanismo que permita a los estudiantes con un nivel B2 en la lengua extranjera desarrollar sus capacidades intelectuales, y al mismo tiempo enriquecer su competencia comunicativa. Entre los instrumentos que se usaron para el proceso de recolección de datos encontramos observaciones directas y participativas, entrevistas, cuestionarios, pruebas, notas de campo y talleres. El análisis de la información se hizo a partir de la técnica inductiva, la cual presentó los siguientes resultados: los procesos cognitivos más implicados en la lectura crítica, los medios o estrategias empleadas por los estudiantes para llegar a un análisis profundo del texto y los beneficios de una lectura dirigida hacia el pensamiento crítico.
La lecture critique pour développer les processus cognitifs chez des étudiants universitaires de FLE niveau B2, une étude qualitative
La lectura crítica como estrategia para el desarrollo de los procesos cognitivos de estudiantes de FLE nivel B2 de una universidad pública, un estudio cualitativo
Critical Reading as a Strategy to Develop Cognitive Processes among FLE B2 Undergraduate Students at a Public University: A Qualitative Study
Karen J. Garay
karenjohanagaray@hotmail.com
Licence en Langues Étrangères Anglais–Français, Enseignante à l'Université de Pamplona, Pamplona, Colombie
Recibido: 18 de enero de 2016
Aprobado: 14 de septiembre de 2017
Résumé
Parmi les capacités permettant à l'être humain de se former intégralement, il y a sa compréhension de la réalité et son adaptation à cette réalité pour ensuite la transformer; mais pour que ces actions soient réalisées, l'application des processus cognitifs est nécessaire. Dans ce contexte, le but de cette étude a été de mettre en place la lecture critique comme un mécanisme qui permet aux étudiants de niveau B2 de développer leurs capacités intellectuelles et en même temps d'enrichir leur compétence communicative. Parmi les instruments employés pour la collecte de données, on peut trouver des observations directes et participantes, des entretiens, des questionnaires, des tests, des notes et des ateliers. L'analyse de l'information a été faite en mobilisant la technique inductive avec les résultats suivants : les processus cognitifs les plus impliqués dans la lecture critique, les moyens ou stratégies utilisés par les étudiants pour arriver à une analyse profonde du texte et les bénéfices d'une lecture dirigée vers la pensée critique.
Mots clés : processus cognitifs, lecture critique, compétence communicative, stratégies.
Resumen
Entre las capacidades que permiten al ser humano formarse integralmente están la comprensión de la realidad y su adaptación a ella, para después transformarla; pero para que estas acciones puedan llegar a ser efectuadas, la aplicación de los procesos cognitivos es imperativa. En esta medida, el objetivo de este estudio es implementar la lectura crítica como un mecanismo que permita a los estudiantes con un nivel B2 en la lengua extranjera desarrollar sus capacidades intelectuales, y al mismo tiempo enriquecer su competencia comunicativa. Entre los instrumentos que se usaron para el proceso de recolección de datos encontramos observaciones directas y participativas, entrevistas, cuestionarios, pruebas, notas de campo y talleres. El análisis de la información se hizo a partir de la técnica inductiva, la cual presentó los siguientes resultados: los procesos cognitivos más implicados en la lectura crítica, los medios o estrategias empleadas por los estudiantes para llegar a un análisis profundo del texto y los beneficios de una lectura dirigida hacia el pensamiento crítico.
Palabras clave : procesos cognitivos, lectura crítica, competencia comunicativa, estrategias.
Abstract
One of the abilities that allow human beings to educate themselves fully is their capacity to understand their reality and adapt themselves to it in order to then transform it, but to perform these actions, it is necessary to execute cognitive processes. In this context, the main goal of this research project is to implement critical reading as a mechanism that allows B2 level students to develop their intellectual capabilities and at the same time to enhance their communicative competence. Instruments used in the data collection process included direct and participant observations, interviews, questionnaires, tests, field notes and workshops. The data analysis was carried out using the inductive technique, which provided the following results: the cognitive processes most implicated in critical thinking, the means or strategies used by the students to reach an in–depth text analysis and the benefits of a reading process oriented towards critical thinking.
Key words: cognitive processes, critical reading, communicative competence, strategies.
La lecture critique est une disposition et une prédisposition du lecteur se confrontant au sens profond du texte, aux idées sous–jacentes de celui–ci, ainsi qu'au raisonnement et aux idéologies (Méndez, Arbeláez, Serna, Espinal & Gómez, 2014). Définie de cette manière, la lecture critique pourrait être employée comme une stratégie multifonctionnelle qui aide non seulement les enseignants, dans leur travail pédagogique, mais qui contribue également au développement des processus cognitifs des étudiants en formation, à travers la prise de position, la confrontation des idées reçues et de leurs préjugés, leur vision du monde et de leur propre réalité tout en améliorant leurs compétences communicatives.
De cette manière, plusieurs études ont été menées en ce qui concerne le développement des stratégies pour améliorer la compétence de compréhension écrite, à partir de différentes perspectives. En effet, certaines études prennent la lecture comme moyen de développement des processus cognitifs (Echeverri & McNulty, 2010 ; Norato & Cañón, 2008) ; d'autres s'intéressent à l'emploi de diverses stratégies afin d'améliorer la compréhension et la production des écrits, (Booth et Land, 2007 ; Quiroga, 2010) ; et on trouve aussi celles qui utilisent la lecture avec des objectifs spécifiques (Arias, 2014 ; Crépeau, 2011).
Cependant, l'un des problèmes les plus fréquents que l'on peut mettre en évidence chez les étudiants de langues étrangères au niveau B2 (CECRL– Cadre européen commun de référence pour les langues), c'est le faible niveau de développement des compétences communicatives. Ceci est constatable au niveau des compétences de compréhension des écrits, où interviennent les processus cognitifs, c'est–à–dire les nombreux processus mentaux lorsqu'une information est reçue par un individu, tels que les savoirs, la compréhension, l'application, la synthèse et l'évaluation (Bloom, 1956) qui peuvent être utilisés simultanément avec les capacités du langage à travers la lecture critique. Cette recherche représente un apport dans ce domaine, en répondant aux questions suivantes :
- Quels processus cognitifs sont les plus impliqués dans l'utilisation de la lecture critique comme stratégie d'apprentissage ?
- Quelles stratégies de lecture favorisent la lecture critique ?
- Quels bénéfices la lecture critique apporte–elle à la compétence communicative de compréhension des écrits des étudiants de langues étrangères ?
Cette étude qualitative a été développée à partir d'une recherche–action avec des étudiants de FLE (français langue étrangère) niveau B2 d'une université publique de Colombie, avec pour objectif d'analyser comment la lecture critique en tant que stratégie d'enseignement peut améliorer les processus cognitifs des étudiants ainsi que leurs habilités communicatives dans le cadre de la compétence de compréhension des écrits.
La méthode de production de données de cette recherche, se fonde sur les instruments suivants : des observations directes et participantes, des entretiens, des questionnaires, des tests, des notes et des ateliers de lecture. Toute l'information collectée a été analysée en utilisant la technique inductive puisqu'elle a permis d'organiser l'information, de l'examiner pour chercher des tendances et de la regrouper afin d'apprécier les résultats comme un ensemble.
En effet, le développement de cette recherche a permis de comprendre les bienfaits de la lecture en classe. Il s'agissait de faire une recherche sur un sujet significatif dans le contexte éducatif actuel pour lequel on ne dispose pas de beaucoup d'études autour de la lecture critique et des bénéfices qu'elle fournirait aux processus cognitifs des étudiants colombiens de FLE. Des études préalables montrent la lecture comme un outil favorisant uniquement les capacités communicatives et laissant de côté l'influence de la partie cognitive.
La lecture comme moyen de développement des processus cognitifs
Les processus cognitifs sont le résultat de certaines activités et d'opérations mentales que les étudiants emploient pour apprendre une langue (Cuq, 2003). Ces processus mentaux peuvent être développés à travers la mise en œuvre des stratégies de lecture, mais aussi à partir de la propre motivation des étudiants à lire pour le plaisir. Ceux–ci requièrent, chez les étudiants des niveaux de préparation élevés, leur adaptation à des activités intellectuelles telles que la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et l'évaluation (Bloom, 1956). Ces processus sont nécessaires pour résoudre les activités de lecture les plus complexes et pour avoir plus de fluidité dans la réalisation des activités orales et écrites (Norato & Cañón, 2008).
Cependant, il y a différentes stratégies de lecture qui sont dirigées vers la pensée critique et qui peuvent enrichir la compétence langagière des étudiants en même temps que leur compréhension des écrits, comme la prédiction, la connaissance préalable, l'organisateur graphique et les questions (Echeverri & McNulty, 2010).
L'emploi de diverses stratégies afin d'améliorer la compréhension et la production des écrits
Il est important que les étudiants emploient des stratégies avec lesquelles ils se sentent plus à l'aise, d'autant plus que l'objectif est d'améliorer la compréhension des écrits. La compréhension des écrits peut être entendue comme un processus complexe qui implique le transfert de connaissances de la langue maternelle, ainsi que le développement de différentes compétences de la langue étrangère (Cuq & Gruca, 2003). En fait, ces auteurs ne limitent pas la compréhension écrite au décodage de signes, au contraire, ils établissent que ce processus implique la construction du sens, la formulation d'hypothèses et l'exploration du texte.
Rodríguez & Rodríguez (2009) ont identifié le fait que les étudiants tendent à employer trois types de stratégies ; les stratégies cognitives qui leur permettent de comprendre les textes, les stratégies métacognitives qui leur donnent la capacité d'identifier les idées principales et secondaires et d'élaborer des stratégies pour travailler, et les stratégies affectives qui contribuent au contrôle de l'anxiété et des émotions pendant l'interaction et la participation. Néanmoins, il y a des cas où il sera nécessaire d'employer certaines stratégies proposées par l'enseignant (reading speed, non–text information, word attack skills, text attack and discursive strategies) pour pouvoir déterminer les principaux besoins des étudiants (Quiroga, 2010).
De leur côté, Booth & Land (2007), affirment que les outils de pensée comme par exemple les projets, permettent aux lecteurs et aux écrivains de construire du sens. Quand les professeurs travaillent avec ce type d'outils, les résultats des étudiants changent, puisque le travail langagier est différent ; ce travail demande un enseignement plus explicite qui pourvoit des guides pratiques dans une variété de stratégies qui aide les apprenants à lire et à écrire des textes plus exigeants. De cette façon, les apprenants pourront reconnaître les stratégies permettant d'améliorer leurs capacités de lecture et d'écriture analytique, de développer plus de confiance en eux, et de plus s'investir pour réussir.
La lecture avec des objectifs spécifiques
La lecture est employée aussi comme une manière significative de promouvoir l'apprentissage de la langue et des processus cognitifs à partir de conditions réelles qui permettent aux étudiants de développer leurs compétences individuelles et sociales. Dans ce sens, il est nécessaire de sélectionner le matériel approprié aux intérêts, à l'âge, aux expériences, aux nécessités et aux connaissances des étudiants (Ríos & Valcárcel, 2005).
Pour cette raison, la lecture doit devenir une pratique consécutive, une action qui considère les aptitudes, la motivation et la capacité des étudiants pour comprendre n'importe quel type de texte. Quand la lecture se travaille d'une manière spécialisée comme c'est le cas du FOS (Français sur Objectifs Spécifiques), on peut mettre en évidence une augmentation non seulement dans la compétence lexicale, mais aussi dans tout ce qui concerne la connaissance d'un domaine spécifique ; sans oublier la motivation qui émerge chez les étudiants pour employer la langue étrangère dans des situations réelles (Arias, 2014).
MéthodologieAfin de répondre aux questions proposées, cette recherche s'est appuyée sur deux observations directes et participantes pour pouvoir observer et analyser le phénomène. Ce type d'outil a permis au chercheur d'être impliqué dans le contexte et en même temps de faire partie des activités développées. En outre, la prise de notes a été nécessaire pour documenter et décrire tous les événements, les activités et les phénomènes observés. D'autres instruments ont également été employés (voir Annexe 1), à savoir : un entretien avec le professeur et une grille d'observation pour avoir une autre perspective au moment de sélectionner la population, un test diagnostic pour mesurer le niveau des étudiants et un questionnaire introspectif.
Comme il s'agit d'une recherche–action, quatre ateliers ont été structurés pour travailler la lecture critique en français étape par étape à travers un guide de lecture critique (Annexe 2), et à l'aide d'une grille d'observation des processus cognitifs (Annexe 3). De plus, il a été nécessaire de faire des enregistrements sonores pour documenter le déroulement de l'atelier, analyser le progrès de la compréhension écrite et le développement des processus cognitifs. À la fin, six entretiens ont été menés en espagnol pour déterminer les stratégies qui contribuent le mieux aux processus de lecture critique, et un test pour déterminer s'il y a eu une amélioration dans la compétence de compréhension écrite des étudiants.
Pour analyser les données, il a été nécessaire de comprendre et de savoir comment donner du sens aux informations recueillies ; donc, pour commencer le processus d'interprétation, on a privilégié la méthode d'analyse inductive.
On a choisi cette méthode d'analyse parce qu'elle a permis d'analyser l'information en partant des éléments spécifiques pour ainsi générer des connexions entre eux. L'analyse inductive commence par la reconnaissance de particularités à l'intérieur des données à partir de la lecture, suivie de l'identification des structures d'analyse, de la création de thèmes basés sur des relations sémantiques, la recherche des sujets dans l'ensemble des domaines, et la création d'un « master outline » qui présente les données comme un ensemble d'information significative (Hatch, 2002).
Résultats
Les processus cognitifs les plus impliqués dans la lecture critique
Parmi les objectifs précédemment établis on trouve l'intérêt à reconnaître les processus cognitifs qui sont considérablement liés à la lecture critique. Les processus qu'on a pris comme point de référence sont exposés par Bloom (1956) qui propose une taxonomie qui est souvent mise en œuvre par les facultés cognitives dites supérieures et qui permet de situer le niveau de compréhension des élèves. Dans ce cas, à partir des ateliers de lecture critique et de la prise de notes, on a identifié que les processus les plus influents ont été ceux de la connaissance, la compréhension et l'évaluation.
Le niveau de connaissance détermine la capacité des étudiants à identifier, examiner, définir et décrire des informations, et acquérir des connaissances de dates, d'évènements et de lieux. Effectivement, pendant le déroulement des ateliers de lecture, les étudiants ont été appelés à reconnaître la source, la typologie, le genre, les mots clés, l'organisation du texte, à retrouver le plan, ainsi qu'à discerner les éléments essentiels du texte. En effet, les notes prises au cours de ces ateliers mettent en évidence l'incidence et la pertinence de la maîtrise du contenu du texte pour le lire de façon critique.
Au moment de faire des hypothèses pour déterminer le type de texte à partir du titre, les étudiants Y4, Y15, Z6 ont dit « qu'il était informatif tandis que l'étudiant Y14 a dit qu'il était argumentatif parce qu'elle croyait que le mot qui était dans le titre « réhabiliter » lui donnait une idée de la position de l'auteur » (Note de l'atelier 2, chercheur).
En ce qui concerne la compréhension, on trouve la capacité des étudiants à interpréter des informations, capter les signifiés, déplacer la connaissance vers de nouveaux contextes, interpréter des faits, comparer, ordonner, regrouper, conclure et prédire des conséquences. Au cours d'un atelier, on a demandé aux étudiants d'analyser pourquoi l'auteur emploie des exemples dans le texte argumentatif et certain d'entre eux ont répondu « Pour attirer l'attention des lecteurs, parce que les exemples sont des situations que l'auteur a déjà vécues, donc il parle à partir de son expérience » (Note de l'atelier 2).
Ces types de commentaires montrent des indices d'identification de l'intentionnalité du texte et de l'auteur même, de l'analyse des ressources utilisées par l'auteur en vue de supporter soit les idées principales soit les idées secondaires. Il faut dire que ce niveau de pensée correspond aussi à la capacité des étudiants à repérer le thème, à identifier des informations détaillées, à deviner le sens de mots et des expressions difficiles grâce au contexte dans lequel elles sont employés.
D'un autre côté, le processus d'évaluation nécessite que l'apprenant soit capable de juger des résultats, de comparer et de discriminer des idées, de donner de la valeur à la présentation de théories et d'arguments, de vérifier l'efficacité de l'évidence et de reconnaître la subjectivité. Pour pouvoir analyser ce processus, l'utilisation d'un texte argumentatif a été indispensable puisqu'il a fourni aux étudiants tous les éléments clés pour examiner en profondeur la précision, la cohérence globale, la formulation et la signification des mots exprimés par l'auteur.
Pendant l'exercice, les apprenants ont été priés d'évaluer de façon critique le discours d'un auteur dans un texte argumentatif en exprimant « Il est blessé à cause des critiques faites au processus d'enseignement, cependant les arguments qu'il présente ne semblent pas être suffisants pour convaincre le public » (Note de l'atelier 4). Ce commentaire montre comment les étudiants ont commencé à examiner des éléments du texte argumentatif (dans ce cas son caractère subjectif) à partir des expressions, du ton, et des arguments et idées que l'auteur a employées pour défendre sa position.
Le partage et la confrontation de perspectives analytiques pendant le déroulement des ateliers ont lancé une série de débats parmi les étudiants. Ces débats ont incités ces derniers à prendre position, à exprimer des accords et des désaccords, à employer des exemples de la vie réelle pour justifier leurs réponses, à analyser le style d'écriture de l'auteur, à réfléchir sur le texte et son impact sur le monde, et à libérer leur sensibilité pour identifier des indices d'ironie, de désespoir ou d'éclaircissement. En outre, la conception des étudiants sur l'objectif de lecture a changé, comme ils ont pu en témoigner :
Lire de façon critique requiert d'ouvrir l'esprit, c'est plus que simplement lire, il s'agit de réfléchir à ce que l'auteur veut nous communiquer et aussi de prendre une position à partir de cela, de plus, c'est très utile quand vous l'utilisez dans d'autres domaines de la vie. (P3, entretien 1).
Les moyens utilisés par les étudiants pour arriver à une analyse profonde du texte
Dans le but de répondre à la deuxième question de recherche, on a pris en compte les stratégies suggérées par Tagliante (2006) orientées vers une lecture compréhensive ; telles que le repérage, l'écrémage, le survol, et l'approfondissement. Les résultats suivants ont été tirés d'un questionnaire soumis aux étudiants avant le développement des ateliers et d'un entretien fait après la réalisation des ateliers de lecture critique.
Le repérage c'est la stratégie que les étudiants emploient pour consulter des informations précises. Généralement, ce type de stratégie se révèle utile dans la recherche sélective dans des documents comme des annuaires, des formulaires, des index, des bibliographies, des dictionnaires, des sommaires brefs, des chapeaux d'articles et des brochures. Par rapport à son utilisation, un étudiant a indiqué au cours de l'entretien : « Avant de lire le texte, j'inspecte sa longueur, s'il est long ou court, j'analyse aussi les questions auxquelles je dois répondre, de plus, j'en fais un examen très rapide pour tout de suite commencer à le lire » (P17, entretien 1).
En outre, les participants ont mis le repérage en application pour chercher le vocabulaire inconnu à l'aide du dictionnaire ou à travers l'inférence du sens, ainsi que pour trouver des relations entre les mots du titre et le texte.
À l'égard de l'écrémage, on trouve que cette stratégie s'applique particulièrement aux documents courts, aux articles de presse, aux pages de littérature et aux recueils de textes, où l'objectif est d'aller à l'essentiel. Dans ce cas, ce qui a été remarquable c'est la façon dont les étudiants l'ont employé pour identifier ce qui est important ou nouveau. Ce processus est déterminant pour pouvoir adopter une posture critique envers le texte. À ce sujet, un étudiant a déclaré que : « Tout d'abord j'essaie d'identifier le titre, le sujet, le type de texte, la source, l'auteur, si le texte est simplement un extrait ou s'il est complet, et de comprendre surtout le vocabulaire, les mots clés de chaque paragraphe » (P13, entretien 1).
De plus, quelques participants ont expliqué que pendant la sélection de l'information ils soulignent ce qu'ils considèrent intéressant, et quelques fois ils font différents exercices qui leur permettent d'organiser l'information et de mieux la comprendre comme par exemple dessiner des symboles sur le texte, des résumés, des tableaux conceptuels et même imaginer ce qu'ils sont en train de lire.
D'autre part, le survol comprend l'intérêt global d'un texte long, d'un ouvrage, d'un article, d'un journal ou d'une revue. Dégager l'idée directrice, l'enchainement des idées, le plan suivi, la structure d'ensemble, sélectionner les passages intéressants en éliminant les détails, sont quelques points qui sont attribués à cette stratégie. Conformément à ce qui précède, les participants ont été invités à expliquer quels éléments les aident à mieux comprendre le texte, et PY4 a répondu :
Parmi les éléments qui m'aident, je pense à comprendre le texte je trouve principalement la strupure, oui l'identification de la structure, c'est–à–dire apprécier de quelle manière est organisé le texte, donc par exemple le texte commence toujours avec une introduction du sujet, après j'essaie de suivre la séquence de l'auteur pour ne pas perdre le fil conducteur [...] (PY4, entretien 1).
Néanmoins, la plupart d'entre eux ont souligné l'importance de la relecture et de la reformulation des idées, en affirmant qu'elles sont le point de départ pour une bonne compréhension et pour dégager le sujet.
Dans cet ordre d'idées, la façon dont les étudiants ont commencé à réfléchir sur l'importance d'avoir un plan, une séquence de lecture avant de se confronter au texte est évidente. Contrairement à ce qu'ils ont exprimé dans le questionnaire au début des ateliers de lecture, on a découvert que les participants ont commencé à adopter inconsciemment les stratégies travaillées dans chaque session, en abordant le texte généralement à partir de la méthode inductive. Par rapport à cette affirmation le participant P16 a manifesté : « Travailler la lecture comme ça, m'a permis de faire attention aux détails du texte qui peuvent m'aider à le comprendre, à inspecter en profondeur le sujet, l'intention, le public, la raison d'être du texte » (P16, entretien 1).
Néanmoins, durant tout le processus de la collecte de données, on a pu constater qu'il y a d'autres stratégies qu'ils mettent en place selon leurs intérêts, leur confort et leur intention de lecture, tels que le surlignage, la relecture, l'inférence de sens, la reformulation, l'organisation de l'information, et l'utilisation du dictionnaire.
Les bénéfices d'une lecture dirigée vers la pensée critique
Les bénéfices apportés par la mise en place de la lecture critique au processus d'apprentissage d'une langue étrangère sont remarquables. À partir du déroulement des ateliers et d'un entretien fait avec les participants, on a pu identifier qu'il y a des bienfaits qui font partie du développement de la compétence communicative telles que la compétence discursive et lexicale, comme d'autres qui ont émergé grâce à la progression mise en évidence dans les exercices de lecture.
Selon le Cadre commun de référence, la compétence discursive fait référence à la capacité des étudiants pour organiser des phrases et leurs composantes, à la capacité de les maîtriser, de gérer et de structurer le discours pour produire des ensembles cohérents. De ce fait, chaque atelier exigeait l'analyse du texte pour poursuivre avec la réponse et son argumentation. Conformément à cette dynamique de travail l'apprenant devait maîtriser les termes et bien comprendre le texte pour ainsi être capable d'organiser sa production orale et défendre son point de vue en argumentant à partir des éléments présents dans le texte. À propos de cette compétence le participant Z13 a remarqué que : « Ce type d'exercice a été utile principalement pour mon cours de français, j'ai dû apprendre à argumenter, à défendre mes idées, à éclaircir les mots de l'auteur pour pouvoir bien interpréter le texte, d'une manière critique... » (Z13, entretien 1).
D'autre part, la lecture critique a aussi des bénéfices au niveau lexical. La compétence lexicale comprend la capacité à utiliser le vocabulaire d'une langue, implique la maîtrise d'une bonne gamme de vocabulaire pour les sujets les plus généraux et les plus relatifs à son domaine, un lexique qui permet à l'utilisateur de la langue d'éviter des répétitions fréquentes. En effet, pendant le développement des ateliers on a choisi une variété de sujets à travailler, les étudiants ont été appelés à chercher le vocabulaire inconnu, à le maîtriser pour tout de suite l'employer pendant la phase d'analyse et d'argumentation du texte. Au sujet de son utilisation, l'étudiant Y14 a indiqué : « On commence à acquérir plus de vocabulaire, donc quand on va lire un texte il est plus facile de le comprendre, d'identifier le sens du document et l'intention que l'auteur veut nous transmettre puisqu'on sait des mots nouveaux » (Y4, entretien 1).
Par ailleurs, il y a d'autres aspects que les étudiants ont identifiés comme favorables pendant l'exercice de lecture critique. Conformément aux entretiens, les étudiants ont fait part d'une acquisition de connaissances clés sur la France dû à la variété de thématiques sociales, culturelles, politiques et académiques traitées dans les textes. De plus, ils ont insisté sur le fait qu'à travers cet exercice ils ont commencé à lire pour penser de façon critique, c'est–à–dire, qu'ils se sont vus forcés à apprendre à évaluer le texte depuis toutes ses dimensions, à analyser chaque extrait du texte et à être perceptif aux éléments essentiels pour pouvoir émettre des jugements de valeur.
À travers cet exercice j'ai appris à lire en pleine conscience, à penser à la lecture et à écouter de façon réceptive, à pouvoir prendre une position face au texte et à choisir ce que je dois incorporer à mon processus d'apprentissage et ce que je dois laisser du côté (Y8, entretien 1).
À partir des observations faites pendant le déroulement des ateliers, les participants ont relevé un progrès significatif, spécialement dans l'analyse de ce qui est lu à travers certains éléments de la pensée comme la question, le but, le point de vue, les suppositions, les implications, l'information, les conclusions et les concepts. En outre, ils ont montré à la fin la capacité à évaluer un texte à partir de sa qualité, sa précision, son importance, la profondeur de son contenu ; et surtout la capacité à pouvoir parler en rapport avec la voix de l'auteur, de se préparer à discuter et à répondre à n'importe quelle question qui devient relative à ce qui a été déjà lu. Ces facultés qui peuvent sembler faciles à développer nécessitent de bonnes bases de formation puisqu'elles sont le point de départ pour arriver à être une personne capable de comprendre, d'analyser et de transformer le monde qui l'entoure.
Quelques éléments de conclusion
La conclusion qu'on peut tirer au terme de ce projet sur l'utilisation de la lecture critique comme stratégie de développement de processus cognitifs chez les étudiants de français langue étrangère pourrait se résumer comme suit :
La lecture critique peut fonctionner comme un mécanisme qui contribue au développement des processus cognitifs des étudiants en même temps qu'au progrès de leurs capacités communicatives. À partir des résultats obtenus de l'application de divers instruments on a constaté qu'une lecture conçue pour la pensée critique stimule de façon substantielle les six niveaux de la pensée proposés par Bloom (1956). Cependant, il y a plus d'incidence dans les niveaux de connaissance, de compréhension et d'évaluation.
D'autre part, on a identifié la tendance des étudiants à employer les stratégies de lecture qu'ils sont habitués à utiliser. Néanmoins, pour travailler la lecture critique le professeur doit leur fournir une série de paramètres à suivre pendant la lecture ; de cette façon les étudiants commenceront à aborder le texte selon leur intention de lecture et à adopter certaines habitudes personnelles pour mieux lire et mieux comprendre les différents types de textes.
Au sujet des bienfaits, on a pu constater un progrès non seulement dans les différents éléments de la compétence communicative, mais également dans les facultés cognitives des étudiants, dans l'apprentissage de connaissances nouvelles à propos des aspects au niveau social, culturel, politique, académique et économique ; et le plus marquant, à percevoir le monde de façon critique.
Implications pédagogiques
Travailler la lecture critique en salle de classe implique de relever de nombreux défis ; une bonne préparation, une documentation appropriée, beaucoup de disponibilité et de patience. L'un des grands problèmes auxquels les étudiants colombiens font face c'est leur difficulté à lire de façon critique, peut–être parce qu'ils n'ont pas suivi une formation précise car chaque enseignant a supposé que ce travail avait déjà été fait par quelqu'un d'autre ou simplement parce que l'étudiant n'est pas intéressé à le faire.
C'est pourquoi les enseignants ne devraient pas partir du présupposé que les étudiants connaissent déjà la dynamique du travail. Il leur faudrait développer une lecture pour la pensée critique qui implique de : commencer de zéro ; enseigner à lire les différents types de textes ; conceptualiser tout ce que nos étudiants sont censés avoir appris auparavant ; stimuler l'intérêt pour la lecture, pour connaître le monde, pour le comprendre, en les aidant à forger leur identité et à jouer un rôle dans le monde à partir de leurs propres jugements.
Références
Arias, G. (2014). Reading through ESP in an undergraduate law program. Profile, 16(1), 105–118. doi: 10.15446/profile.v16n1.36823
Bloom, B. (1956). Taxonomía de los objetivos de la Educación: la clasificación de las metas educacionales: Manuales I y II. Madrid, Espagne: El Ateneo.
Booth, C., & Land, R. (2007). A cognitive strategy approach to reading and writing instruction for English language learners in secondary school. Research in the Teaching of English, 41(3), 369–303. Récupéré de http://www.nwp.org/cs/public/download/nwp_file/8538/Booth_Olson,_Carol,_et_al.pdf?x–r=pcfile_d
Crépeau, N. (2011). Une étude descriptive et exploratoire des stratégies de lecture d'étudiants autochtones en première année d'université Tesis de maestría). Récupéré de Cégep de l'Abitibi–témiscamingue Université du Quebec en Abitibi–témiscamingue. (http://depositum.uqat.ca/274/)
Cuq, J. (2003). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris, France : CLE international.
Cuq, J., & Gruca, I. (2003). Cours de didactique du Français langue étrangère. Grenoble, France: Presses universitaires de Grenoble.
Echeverri, L., & McNulty, M. (2010). Reading strategies to develop higher thinking skills for reading comprehension. Profile, 12(1), 107–123. Récupéré de http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/13980
Hatch, A. (2002). Doing qualitative research in educational settings. New York: University of New York press.
Méndez, J. C., Arbeláez, D. C., Serna, C., Espinal, C., & Gómez, J. A. (2014). La lectura crítica en la educación superior: un estado de la cuestión. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 41, 4–18. Récupéré de http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/461/983
Norato, A. & Cañón, J. (2008). Developing cognitive processes in teenagers through the reading of short stories. Profile, 9(1), 9–22. Récupéré de http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/10676
Quiroga, C. (2010). Promoting Tenth Graders' Reading Comprehension of Academic Texts in the English Class. Profile, 12(2), 11–32. Récupéré de http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/17630
Ríos, R. & Valcárcel, A. (2005). Reading: A meaningful way to promote learning English in high school. Profile, 6(1), 59–72. Récupéré de http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/11022
Rodríguez, H. & Rodríguez, B. (2009). Reading Comprehension Strategies: A Case Study in a Bilingual High School. Revista Electrónica Matices en Lenguas Extranjeras, 3. Récupéré de https://revistas.unal.edu.co/index.php/male/article/view/13816
Tagliante, C. (2006). La classe de langue (Nouvelle édition). Paris, France. CLE international
Annexes
Annexe 1. Tableau des activités de recherche

Annexe 2. Guide de travail des ateliers structurés
ATELIER DE LECTURE CRITIQUE
1. Familiarisation avec le texte, identification du texte : chapeau, intertitre, titre, auteur, date, source, lecture des images.
2. Lire attentivement le titre pour faire des hypothèses sur le type de texte (informatif, argumentatif, narratif...).
3. Lire attentivement le titre pour faire des hypothèses sur le texte.
4. Lire le document pour identifier : qui parle, de quoi (thème), quand, à qui il s'adresse, et où.
5. Repérage de la macrostructure du texte.
6. Le type de texte, le genre et sa fonction.
Fonctions :- Persuasive: une publicité, un discours politique, un article d'opinion, une critique d'art, une lettre.
- Expressive : une poésie, un roman, un conte, une lettre.
- Informative : une nouvelle, un article de presse, un texte scolaire, une lettre, une affiche.
- Poétique : page de roman, littérature d'idées, essai, échange de répliques dans une pièce de théâtre.
7. Identification des éléments qui permettent de déterminer le type de texte.
8. Identification de l'organisation du texte et relever les indices d'une chronologie :
- Le plan chronologique.
- Le plan thématique.
- Le plan antithétique.
9. Identification de sous–titres.
10. Identification de mots clés (selon chaque paragraphe) et révision des signifiés.
11. Identification des mots inconnus.
12. Identification des éléments qui peuvent être mis en relation avec les mots inconnus.
13. Signifié des mots inconnus.
14. Proposition des synonymes pour les mots inconnus et vérification du sens.
15. Lecture globale pour identifier l'idée générale du texte.
16. Repérage des connecteurs logiques/organisation du texte.
17. Lecture par paragraphes pour vérifier leur compréhension exhaustive.
18. Identification de l'idée centrale de chaque paragraphe et les idées secondaires.
19. Résumer et synthétiser en quelques lignes le thème du texte.
20. Reconnaissance de signifiés cachés du texte (connotations positives, négatives).
21. Reformuler des idées du texte (utilisation des exemples).
22. Analyse critique du texte :
- Énonciation de l'intention (claire, vague, confuse).
- Précision de l'auteur.
- Identification de la position ou point de vue de l'auteur (objectivité — subjectivité)
- Consistance des arguments de l'auteur (contradictions, ambiguïté, concordance)
- Ton du texte/ auteur (optimiste, pessimiste, neutre).
- Profondeur du texte.
- Des apports que fait le texte.
- Des questions que suscite le texte.
- Des polémiques et la prise de position.
Optionnel :
Construction d'un nouveau texte à partir des idées de l'auteur (un résumé, un texte autochtone).
Guide adapté de différentes sources.
Annexe 3. Grille d'observation des processus cognitifs dans la compréhension des écrits
ATELIER 1
Date : ______________ Objectif : Analyser les processus cognitifs de l'étudiant à partir du développement des ateliers de compréhension écrite.
Échelle d'évaluation : 1 (Non) – 2 (avec difficulté) – 3 (très bien).
Matices en Lenguas Extranjeras, número 10. ISSN 2011–1177.
Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas – Departamento de Lenguas Extranjeras.
Bogotá. http://revistas.unal.edu.co/index.php/male
Referencias
Arias, G. (2014). Reading through ESP in an undergraduate law program. Profile, 16(1), 105-118. doi: 10.15446/profile.v16n1.36823
Bloom, B. (1956). Taxonomía de los objetivos de la Educación: la clasificación de las metas educacionales: Manuales I y II. Madrid, Espagne: El Ateneo.
Booth, C., & Land, R. (2007). A cognitive strategy approach to reading and writing instruction for English language learners in secondary school. Research in the Teaching of English, 41(3), 369-303. Récupéré de http://www.nwp.org/cs/public/download/nwp_file/8538/Booth_Olson,_Carol,_et_al.pdf?x-r=pcfile_d
Crépeau, N. (2011). Une étude descriptive et exploratoire des stratégies de lecture d’étudiants autochtones en première année d’université (Tesis de maestría). Récupéré de Cégep de l’Abitibi-témiscamingue Université du Quebec en Abitibi-témiscamingue. (http://depositum.uqat.ca/274/)
Cuq, J. (2003). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris, France : CLE international.
Cuq, J., & Gruca, I. (2003). Cours de didactique du Français langue étrangère. Grenoble, France: Presses universitaires de Grenoble.
Echeverri, L., & McNulty, M. (2010). Reading strategies to develop higher thinking skills for reading comprehension. Profile, 12(1), 107-123. Récupéré de http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/13980
Hatch, A. (2002). Doing qualitative research in educational settings. New York: University of New York press.
Méndez, J. C., Arbeláez, D. C., Serna, C., Espinal, C., & Gómez, J. A. (2014). La lectura crítica en la educación superior: un estado de la cuestión. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 41, 4-18. Récupéré de http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/461/983
Norato, A. & Cañón, J. (2008). Developing cognitive processes in teenagers through the reading of short stories. Profile, 9(1), 9-22. Récupéré de http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/10676
Quiroga, C. (2010). Promoting Tenth Graders’ Reading Comprehension of Academic Texts in the English Class. Profile, 12(2), 11-32. Récupéré de http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/17630
Ríos, R. & Valcárcel, A. (2005). Reading: A meaningful way to promote learning English in high school. Profile, 6(1), 59-72. Récupéré de http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/11022
Rodríguez, H. & Rodríguez, B. (2009). Reading Comprehension Strategies: A Case Study in a Bilingual High School. Revista Electrónica Matices en Lenguas Extranjeras, 3. Récupéré de https://revistas.unal.edu.co/index.php/male/article/view/13816
Tagliante, C. (2006). La classe de langue (Nouvelle édition). Paris, France. CLE international
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Derechos de autor 2016 Matices en Lenguas Extranjeras

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional